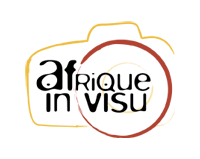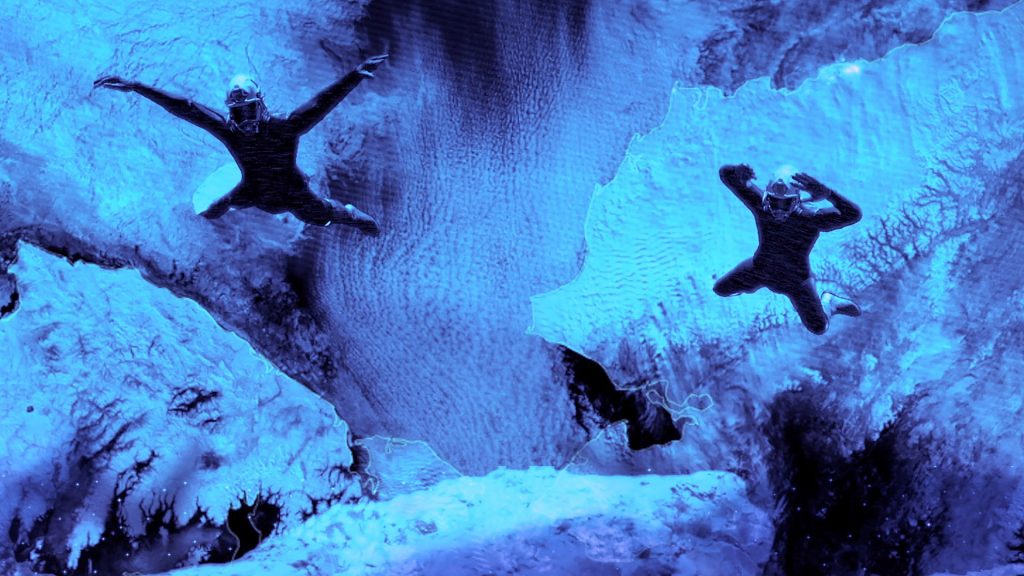Depuis quelques mois, nous suivons le travail du photographe Frédéric Noy. Dans des journaux comme La Croix, le Monde magazine mais surtout sur son site. A travers cette interview, nous souhaitions présenter le parcours atypique de ce photographe qui a passé 11 des 18 dernières années de sa vie sur le continent africain. Une démarche photographique très particulière associée à la chronique. Frédéric Noy revient pour nous sur ses premiers reportages mais aussi sur ses derniers : Chronique de la faim au Tchad et Lost in Revolution en Libye.
Peux-tu nous présenter ton parcours et ta démarche ?
Après un parcours universitaire pluridisciplinaire terminé par une formation en communication j’ai effectué mon service militaire en Tanzanie comme Conseiller Culturel et de Coopération Adjoint à l’Ambassade de France sans même savoir lorsque je postulais où se trouvait ce pays. L’envie de partir, d’ailleurs, d’autre chose me décida, en un instant. Le journalisme, l’écriture et la photographie étaient alors trois modes d’expression qui me taraudaient. Seize mois en Afrique devaient me permettre d’y voir plus clair. Les seize mois se transformèrent en quatre années de longs séjours ponctués de retour en France, au cours desquels je réalisai mes premiers sujets photos : monde agricole tanzanien, Sida sur la zone frontalière septentrionale, plus grand hôpital civil,… S’ensuivit une période de tâtonnements au cours de laquelle j’enchaînais des boulots divers : écriture d’applications interactives pour un Musée, réalisateur de films documentaire et institutionnel, photographe de plateau (Madame Butterfly de F. Mitterand), conseiller en communication,… Au sortir de cette période, en quête de recentrage, je travaillais pour une agence de presse japonaise basée à Paris comme preneur de son et caméraman, à l’exclusion de toutes autres activités. Ce travail alimentaire devait me permettre de financer mes sujets photos. Après quelques années, il s’avéra que l’énergie passée à m’assurer un confort de vie minimum et le peu de temps préservé ne me permettaient pas de me consacrer pleinement à la photographie. Au tournant de l’an 2000, j’abandonnai l’agence de presse pour me consacrer uniquement au reportage photographique. De ce basculement, sortirent Avoir 20 ans à Dar Es Salaam (éditions Alternatives), puis un sujet sur les réfugiés Palestiniens vivant au Sud Liban. Ce dernier fut mon ticket pour entrer à l’agence Cosmos et signa ma première participation à Visa, en projection. Depuis l’équilibre s’opère entre projets personnels, corporate avec des Organisations Internationales et presse.

Avoir 20 ans et les réfugiés Palestiniens sont mes premiers sujets construits considérant l’attention pleine et entière que je leur ai accordée. Ils résument ma démarche d’alors. Vivre en immersion avec les sujets, se documenter de manière à avoir une connaissance précise du contexte sans chercher à shooter des images préconçues, travailler seul en trouvant des relais dans la communauté documentée, privilégier des histoires (généralement en Afrique) décalées ou aux marges de l’actualité, couvrir une question d’actualité dans un lieu qu’on ignore concerné, se focaliser sur des minorités peu montrées, raconter l’Afrique heureuse, laborieuse ou quotidienne.
Comment en es-tu venu à passer 11 des 18 dernières années de ta vie sur le Continent Africain ? Tanzanie, Nigeria, Soudan, Tchad, pourquoi ces pays ?
Le service militaire obligatoire à l’époque me propulsa en Tanzanie sans que je l’ai prémédité ou particulièrement désiré. En fait, je voulais ni me retrouver en caserne, ni chercher un premier emploi frais émoulu de l’Université. J’avais envie d’ouvrir une parenthèse me permettant de garder la photographie en point de mire. Une occasion se présentait Je la saisis. Je trimballais vaguement à propos de l’Afrique images et opinions issues de l’inconscient collectif européen du moment. M’y rendant plus par surprise que par stratégie, j’étais dépourvu de romantisme à satisfaire ou de lecture de jeunesse à mettre en acte. Un pur hasard faisait de moi une page blanche, un jeune homme interloqué et transpirant sur la passerelle de l’avion à l’aéroport de Dar Es Salaam, sans idées ou images préconçues, disponible pour découvrir et retenir toutes histoires passant à ma portée. En me remémorant mes premiers mois africains, je réalise que ma démarche photographique semble le reflet de mon état d’esprit lors de mon arrivée.
Mes seize mois de service furent suivis d’aller-retour entre France et Tanzanie, ponctués de projets professionnels, prétextes à de longs séjours. Las du balancement qui ne me permettait ni d’être proche d’un territoire de récit ni de diffuseurs, je pensais qu’il serait plus pertinent de vivre dans un pays africain, proche d’histoires pour lesquelles ma période tanzanienne m’avait révélé appétence et curiosité. C’était aussi une façon définitive de désintégrer toute tentation d’ethnocentrisme. Vivre en Afrique permettait ainsi de se débarrasser de la tendance à « l’exotisme » inhérent au voyageur occasionnel. En rendant quotidien un pays africain, j’adoptais la démarche du correspondant permanent tout en préservant l’aspect freelance qui me libérait de toute hiérarchie et toute attente émanant d’une structure. Profitant d’une opportunité liée à ma vie personnelle, je m’installais à Abuja, capitale du Nigeria.
Ce pays convenait bien à ma démarche car il concentre une multitude de problématiques qui traversent le continent tout en possédant, ancré à l’âme un allant offensif, revendicatif et orgueilleux, couplé à une inventivité, une créativité et un dynamisme inébranlables. Cette certaine idée de l’africanité n’était pas pour me déplaire et éviterait de biaiser le rapport entre photographe et sujet. De plus aucun photographe étranger n’était alors implanté au Nigeria à la différence des hubs médias comme Nairobi, Dakar ou Johannesburg. Passant de la Tanzanie sortant du socialisme au Nigeria capitaliste, je quittais le romantisme politique pour une modernité plus âpre, plus chaotique, dans un pays conscient de son statut de puissance continentale. Ce sentiment correspondait à mon désir photographique du moment : raconter une société quotidienne, contemporaine, semblable à celle dont j’étais issu, mais en tous points différente et emblématique d’une Afrique décomplexée, puissante, plus grande que nature.
Après quatre années de Nigeria éprouvantes et l’impression d’être photographiquement sec, il était temps de changer d’horizon, sans revenir en France. Les négociations autour du DPA (Darfour Peace Agreement) se passaient alors dans un hôtel d’Abuja. Tout naturellement, mon intérêt se porta sur le nord Soudan. Fin 2005, je quittais en famille le Nigeria pour débarquer à Khartoum début 2006. J’y restais deux années, m’intéressant notamment au Darfour, aux problématiques de déplacés liées aux conflits Soudanais. Dans le même temps, je collaborais avec des institutions internationales. Deux années plus tard, s’avérant de plus en plus difficile de travailler sur le Darfour du Soudan, je passais au Tchad et m’installais à N’Djamena. Cette migration me permit de continuer à suivre les problématiques liées au conflit du Darfour, côté Tchadien, cette fois. Après plusieurs années en Afrique anglophone et arabophone, vivre en sphère francophone était une première. Après près de quatre années au Tchad je revins en France.
Le fait de ne plus vivre en Afrique, près de mes sujets photographiques influence et tend à modifier ma démarche. Difficile et plus chère est l’immersion en vivant à des milliers de kilomètres de ces histoires. De l’influence de la situation géographique sur l’approche photographique…
Tu privilégies le modèle narratif de Chronique, comment travailles-tu ?
Les sujets qui de prime abord m’intéressent sont ceux qui me surprennent, me rappellent la diversité du monde, s’intéressent à des minorités sociales, ethniques, religieuses, économiques,… ou sont liés à des sujets gravitant dans l’actualité que je m’efforce de couvrir sous un angle singulier. Quelle que soit la motivation qui déclenche l’envie de raconter, je m’attache à suivre et à décrire la vie de personnes telle qu’elle se déroule sous mes yeux. Un évènement n’est pas le sujet principal de mes récits, mais la somme des vies, des actions et des attitudes des sujets, acteurs principaux de l’évènement, en est le fil et le constitue. C’est en cela que le mode narratif que je privilégie est la chronique. Des petits riens, des victoires, des moments mis bout à bout constituent des existences, et pour le témoin que je suis une chronique, une histoire, un sujet. En cela, les aléas des autres font mes histoires.
De cette dépendance naît une obligation de respect et de discrétion. Respect dans le rapport que j’entretiens avec les personnes que je photographie, d’où la nécessité de connaître et de décrypter les codes de leur société, me forçant à y vivre en immersion et à l’écoute, pas seulement pour obtenir le meilleur récit, mais pour percevoir ce qui se fait et ce qui insulte. De cette empathie mesurée, au moment où le sujet oublie ma présence car allant de soi, naissent des moments photographiques éphémères et captivants à saisir dans un instant fugace. Quant à la discrétion, elle m’impose de peser le moins possible sur le récit, donc de travailler en équipe aussi réduite que possible ou seul. Ce n’est pas toujours possible quand le temps alloué pour une commande est court.
Tu réalises tes sujets en immersion totale et en travaillant seul la plupart du temps… Pourquoi ce choix ? écris-tu tes textes? Fais-tu des prises de sons ?
Travailler seul est motivé par le besoin de discrétion et le souci de peser le moins possible sur le récit. Cela me permet de me dédier pleinement aux sujets sans me soucier de la présence d’un tiers qui pourrait avoir un rapport différent à la situation, parce que ces attentes seraient différentes et de ce fait pourrait interférer dans le déroulement de l’action. Dans une situation de reportage, j’ai toujours le sentiment que la meilleure photo, celle qui aura le plus de sens ou autour de laquelle le récit pourra s’articuler est à venir. Je suis ainsi souvent dans l’attente et disponible. Il n’est pas facile d’imposer mon rythme, mon attitude de pêcheur à la ligne ou de l’expliquer à une autre personne. Ceci dit, j’ai conscience de la plus-value que serait la collaboration avec un binôme. Question d’affinité d’attitude et d’approche, j’imagine. Finalement, je travaille souvent seul non par principe d’exclusion mais plutôt en attendant de trouver le partenaire adéquat de reportage.
Depuis toujours, l’écriture me tente et gravite autour de mes photographies. Au sortir de la Coopération, en Tanzanie, mon premier client me paya pour des photos, pas pour écrire un papier. Je poursuivis naturellement cette voie. L’occasion de redonner une chance à l’écriture me fut donnée des années plus tard, quand proposant un sujet sur les actrices cinéma au nord Nigeria, le Magazine qui prenait l’histoire n’avait personne pour rédiger l’article. J’avais envoyé à Paris un long brief, devant permettre à une journaliste d’écrire le papier. A la relecture, dès l’introduction, l’article s’avéra truffé de contresens et de raccourcis frisant l’erreur. Il m’était plus difficile de le corriger que de l’écrire. La directrice photo convainquit la rédaction en chef. A cette occasion, j’accompagnais aussi près que possible du lectorat mon reportage en utilisant mes mots et mes images. J’y pris goût et confiance. De plus, proposant régulièrement des sujets « pointus » sur lesquels peu de rédacteurs peuvent écrire immédiatement, il est plus confortable, plus simple, plus rapide, plus vendeur aussi de pouvoir le cas échéant accompagner ses images d’un papier.
Depuis l’arrivée du multimédia, je ménage des moments de prise de sons durant le reportage pour proposer, le cas échéant, une version augmentée d’une histoire, pour le web. Attitude schizophrénique pouvant déboucher sur la frustration de se sentir à contretemps du sujet : en mode prise sons quand une image intéressante ou une lumière parfaite passe sous le regard et en mode photo quand un sujet lâche une phase qui enrichirait le récit…
Peux- tu nous présenter un de tes derniers travaux : pourquoi ce sujet ? (Pourquoi l’avoir traité de cette manière sous forme de chronique)
Chronique de la faim est un sujet fait dans le Kanem, une région sahélienne enclavée de l’ouest tchadien où la vie a toujours été difficile, en équilibre entre le manque et le peu. Elle est située sur la ligne de front imaginaire du réchauffement climatique où ses conséquences se traduisent par l’absence de pluie avec un impact immédiat, rude, tangible et meurtrier sur l’existence des habitants. La conséquence majeure étant la faim, non comme un aléa mais comme une quasi constante. A la même période, une situation équivalente a été abondamment documentée au Niger voisin où interviennent des ONG possédant savoir faire humanitaire et faire savoir. Ce n’est pas la première fois, il y a quelques années déjà. Elle est donc inscrite dans l’inconscient collectif médiatique. Par contre, le Tchad au moment où j’entamais mon premier voyage dans le Kanem n’était pas un terrain connu en la matière.
Le meilleur moyen de souligner que la faim devenait chronique, me semblait de conduire la chronique d’une région taraudée par elle, sans m’attacher à l’aspect plus spectaculaire de la famine. J’ai donc opté pour un suivi de la vie quotidienne des gens parcourant des paysages « apaisés » sur lesquels flottaient le spectre du manque. J’ai effectué trois séjours de plusieurs semaines dans le Kanem sur une période d’une année et demi m’attachant aux pas de victimes potentielles dont les regards, les attitudes, les actions sont une représentation en creux d’une crainte.
On a pu voir de nombreuses images sur le « printemps arabe » et les révoltes actuelles dans les médias. Tu viens de réaliser un de tes derniers sujets en Libye qui se détache de l’actualité et de la mouvance iconographique qu’on a pu voir émerger de ces évènements. Pourquoi ce sujet ? Comment l’as-tu préparé ? Et comment as-tu travaillé sur place ?
De Paris, je suivais l’insurrection libyenne et les conséquences sur les pays voisins. Je me tâtais. Partir ou pas ? Pour des raisons financières, je ne pouvais le faire qu’avec une garantie ou mieux une commande. Par chance, le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) avec qui je travaille régulièrement depuis des années, m’envoya sur la frontière Egyptienne pour documenter la situation des personnes fuyant les combats. A la différence de la situation spectaculaire côté Tunisie, où des dizaines de milliers de personnes s’agglutinaient, je découvris à Sallum (poste frontière Egyptien), qu’ignorés des medias, plusieurs milliers de travailleurs migrants dont beaucoup d’africains subsahariens étaient bloqués, sans les papiers nécessaires pour continuer leur périple. En discutant avec eux, j’eu la confirmation que beaucoup d’autres se terraient à Benghazi de peur d’être agressés par des rebelles, victimes de l’amalgame fait entre noirs africains et mercenaires. Cela confirmait les chiffres du HCR concernant le nombre de travailleurs étrangers en Libye avant la révolution et le nombre de ceux qui avaient passé une frontière. Ayant vécu en Afrique subsaharienne, je me souvenais d’amis Nigerians, Soudanais ou Tchadiens qui fièrement me montraient la photo d’un proche parti travailler « chez Ghadafi ». Je ressentais proximité, empathie et besoin de témoigner d’autant plus que ce sujet me trottait dans la tête depuis mon départ de Paris. Maints photographes et rédacteurs couvraient déjà l’évolution du front, les combats, la joie des révolutionnaires et la vie reprenant à Benghazi. Mon inclinaison à aborder l’actualité sous un angle singulier, ma proximité avec les subsahariens et l’envie de m’intéresser à la part d’ombre des combattants de la liberté me conduisirent à Benghazi. Je voulais retrouver des travailleurs migrants et témoigner de leur situation.
Avec une collègue video producer, nous avons organisé un transport depuis la frontière. A Benghazi, par chance, en parlant aux uns, aux autres, nous avons dégoté le contact d’un tchadien vivant depuis toujours en Libye qui dès le début de l’insurrection s’est intéressé à la situation des travailleurs migrants, par pur altruisme, étant lui-même à l’abri de toute violence par sa situation professionnelle confortable et les années passées en Libye. Intercesseur efficace et discret, il m’emmena dans le quartier où vivent des travailleurs migrants. Pour ne pas attirer l’attention sur les maisons où se cachaient les travailleurs que nous rencontrions, je glissais mes deux boîtiers, deux objectifs et un flash dans un sac à dos qui ne ressemble pas à un sac de photographe pour un œil non averti. La voiture garée en bordure de quartier, nous nous sommes engouffrés dans un dédale de rue.
Ce sujet qui à mes yeux était le sujet à faire à Benghazi, au moment où j’y étais, s’est construit au fur et à mesure, dans la discrétion, grâce à une grande dose de hasard. En effet, il était difficile de s’appuyer sur les autorités révolutionnaires pour relater un aspect « délicat » de leur épopée magnifique. Le traducteur qui m’aida à obtenir l’accréditation auprès du bureau de presse Libyen, éduqué, ouvert, sympathique, soutenait qu’il était dangereux de se rendre dans ce quartier habité par des gens peu recommandables et dont la majeure partie était des mercenaires… Avant de rencontrer les subsahariens, je pris soin de ne pas me faire accompagner par lui. De toutes façons la perspective ne l’enchantait pas.
Quels sont tes projets dans le futur ?
D’un point de vue photographique, étant basé pour l’heure à Paris, ma démarche photographique a été amenée à évoluer et s’avère double. Partir sur des projets courts, en commande ou en spéculation en fonction de l’actualité mais en m’efforçant de préserver une marge de liberté et de création qui se retrouve dans l’angle singulier sous lequel j’aime traiter un sujet déjà couvert par d’autres. Continuer à m’investir dans des sujets plus personnels en Afrique, centrés sur des populations vivant à portée d’une menace ou victimes d’une exclusion. Deux sujets sont en gestation et en écriture. Vous me permettrez de les garder pour moi jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent réellement.