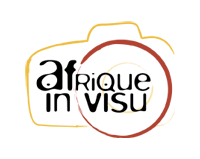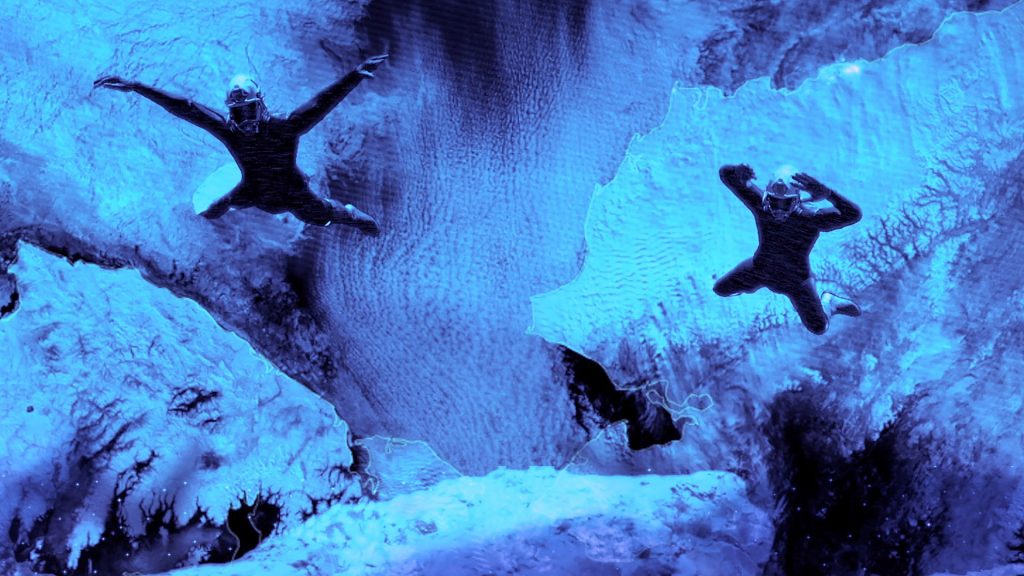Pour cette neuvième édition qui ouvre le 27 octobre 2018, le Lagos Photo Festival s’articule autour du thème Time Has Gone à travers différents travaux d’auteurs majoritairement issus du continent africain ou de sa diaspora qui, tous explorent différentes facettes du temps (sa non-linéarité), de la mémoire et de la complexité de notre expérience de ce dernier. Quatre commissaires ont collaboré sur cette édition: Eva Barois De Caevel, Wunika Mukan, Charlotte Langhorst et Valentine Umansky.
Nous avons proposé à Valentine Umansky de s’entretenir avec Karl Ohiri sur son projet des Lagos Studio Archives, qui interroge la notion de mémoire matérielle et immatérielle à travers la photo de studio et son évolution…
Comment ce projet spécifique consacré aux archives photographiques nigérianes fait-il écho à votre propre pratique photographique, Karl ?
Le projet des Lagos Studio Archives semble être une progression naturelle et découle des interactions permanentes que j’entretiens avec Lagos, ce lieu que j’appelle encore mon chez-moi. En tant qu’artiste anglo-nigérian, citoyen de ces deux pays, j’ai souvent exploré les différences et les similitudes entre ces deux pays au sein de mon travail. Etant né au Royaume-Uni mais voyageant fréquemment au Nigéria depuis mon enfance, mes racines et mon héritage familial ne m’ont pas quitté.
Ces visites régulières m’ont permis de produire un travail qui reflète de façon critique certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui en tant que Nigérians, tels que la préservation de notre patrimoine culturel. Je pense que c’est un domaine de notre culture qui est souvent sous-estimé. J’essaie donc de promouvoir ces idées par mes projets artistiques. C’est flagrant dans My Granddad’s Car (La voiture de mon grand-père), un projet que j’ai mené en collaboration avec un ami, durant cinq ans, et qui nous a permis de retourner dans nos pays d’origine respectifs et d’exporter les voitures de nos grands-pères vers le Royaume-Uni.
J’ai été intrigué par les réactions des habitants de chaque pays à l’égard de ce projet. La plupart des gens que j’ai rencontrés au Nigeria étaient perplexes et estimaient que je perdais mon temps et mon énergie à exporter une voiture rouillée vers le Royaume-Uni, tandis que la plupart des Britanniques célébraient l’ambition du projet et en appréciaient le potentiel artistique.
Alors que la voiture franchissait les frontières de mes deux foyers, j’ai commencé à réfléchir à la nature subjective de la notion de « valeur ».
Mon dernier projet (Lagos Studio Archives) a le même point de départ. Il examine un ou plusieurs objets mis au rebut – dans ce cas des archives photographiques – et tente d’en montrer l’importance : de leur redonner vie, les réinsérer dans l’espace culturel, par le franchissement des frontières et la remise en question de la valeur qui leur est attribuée.

Comment avez-vous choisi les studios de photographie ? Les photographes qui ont pris ces photographies étaient-ils des artistes « reconnus » pour leur profession ou bien des amateurs ?
Le choix des studios de photographie est venu par hasard. Comme je suis toujours basé à Lagos lors de mes visites au Nigéria, je me suis concentré sur cette ville. J’ai demandé à un ami photographe de téléphoner aux photographes locaux. La plupart d’entre eux étaient en train de jeter leurs archives argentiques car le monde de la photographie passait au numérique. Beaucoup considéraient ces photographies comme « purement professionnelles » et ne leur conféraient aucune valeur artistique ou historique. C’est pourquoi une fois passés au numérique, ils détruisaient ou abandonnaient leur leurs négatifs.
Mon intention n’a jamais été de rechercher des photographes « renommés » et il est impossible de dire si certains d’entre eux le sont ou le seront à l’avenir, suite à la redécouverte de leur travail. Tout ce que je peux dire, c’est que ces photographes sont d’aussi bons portraitistes que ceux que j’ai rencontrés ailleurs et que les images qu’ils ont prises sont riches d’un point de vue culturel. Elles capturent réellement l’esprit de Lagos.
Nous nous sommes rencontrés en février et nous avons rapidement démarré une longue conversation sur l’importance des archives photographiques. Quel était votre point de vue sur cette question ?
Je considère toujours ces archives du point de vue historique et je suis très enthousiaste à l’idée de mieux les connaître et de les faire connaître. A l’époque, j’essayais de trouver des photographies 35 mm en couleur des habitants de Lagos, et je me suis vite aperçu à quel point cette iconographie est absente. Il y a très peu d’images couleur issues de studios photographiques qui sont accessibles. Ce projet donne un aperçu d’une histoire qui était auparavant cachée, mettant en valeur le talent de certains de ces photographes extraordinaires.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la provenance des archives photographiques : comment les avez-vous créées ? Comment avez-vous eu l’idée de collectionner la photographie nigériane vernaculaire ?
La collection de photographies de portraits en studio que je conserve a une longue histoire. Avec le recul, je pense que ce qui m’a le plus influencé est un livre que j’ai lu lors de mes études de photographie à la Golsmiths University de Londres. Je me souviens de m’être assis dans une salle de conférence pour lire Twin Lens Reflex – The Portrait Photographs of Harry Jacobs and Bandele “Tex” Ajetunmobi. Ce livre qui inclut les photographies de Harry Jacobs, notamment ses portraits des migrants, et en particulier ceux de la génération Windrush, m’ont profondément marqué. J’ai adoré la façon dont il rend visible leurs luttes personnelles et leurs aspirations. Une autre section du livre décrit ce qu’ils les « archives accidentelles » du photographe Tex. Il était sur le point de jeter toutes ses archives quand sa nièce les a trouvées. J’ai pris conscience de l’idée de longévité des archives. Cela explique sans doute pourquoi, des années plus tard, je me suis mis à collectionner la photographie vernaculaire nigériane.
Tout a commencé avec un photographe de studio à Owerri (Nigéria). Nous avons eu une conversation au sujet de la photographie, ce qui m’a amené à lui demander s’il pouvait me montrer certains des vieux portraits de studio qu’il avait pris. Il a répondu qu’il avait mis toute sa collection à la poubelle une semaine avant mon arrivée. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m’a répondu qu’il s’agissait d’une chose très courante et que tous ses amis photographes avaient fait la même chose, après être passés au numérique.
L’année suivante, alors que je me rendais à Lagos, j’ai rendu visite à un ami photographe qui dirige un studio de photographie et lui ai demandé s’il avait des négatifs. Il m’a raconté une histoire similaire – il avait brûlé ses négatifs deux ans auparavant. J’ai compris qu’il s’agissait d’une pratique courante au Nigéria et décidé d’appeler les photographes uns à uns. L’intention était simple : je voulais éviter que ce que je percevais comme une histoire photographique ne soit tout simplement effacée.
Pouvez-vous me parler un peu de ce qui se passait au Nigéria entre 1980 et 2010 – la période que ces archives recouvrent ?
On y lit un intérêt pour la mode, mais une mode fortement influencée par la culture occidentale même si de nombreux modèles demandaient être représentés en tenue traditionnelle. C’est l’une des nombreuses questions j’espère étudier plus en profondeur lorsque je débuterai réellement mes recherches sur ce fonds photographique.
Quel est le but de votre projet ? Et comment les studios sont-ils impliqués, s’ils le sont ?
Le projet a pour but de préserver certaines des archives qui étaient sur le point d’être détruites et de sensibiliser les générations futures sur l’importance de la préservation de l’histoire culturelle photographique. J’espère que cela apportera un éclairage nouveau sur la photographie de studio au Nigeria et fournira une plate-forme pour que se développe un discours critique autour de cette iconographie.
Il me semble important d’impliquer les studios dans le projet une fois que j’en aurai une meilleure connaissance et que j’aurai pu déterminer les questions à leur poser. Je le ferai quand le moment sera venu, afin que la conversation soit réellement fructueuse. Je vois le projet comme une collaboration avec ces photographes, bien qu’ils n’aient pas eux-mêmes accordé de valeur, autre qu’économique, à leur propre travail. D’une certaine manière, j’espère changer leur perspective en leur montrant leur travail dans un nouveau contexte. Certains photographes de studio ont beaucoup de visibilité ; c’est le cas de Malick Sidibé, le photographe malien, ou du célèbre photographe nigérian J.D. ‘Okhai Ojeikere. Tous deux ont une renommée internationale. Les photographies qui sont regroupées dans ce que j’appelle les Lagos Studio Archives sont esthétiquement comparables à celles de ces photographes et offrent un aperçu de la vie à Lagos dans ces années, ce qui sera inédit pour beaucoup de gens il me semble.


Nous avons aussi parlé ensemble de la notion d’appropriation culturelle. Comment vous situez-vous à ce propos ? Je repense au travail d’Hank Willis Thomas et des critiques qu’il a reçues pour son « appropriation » (on a parfois parlé de « vol ») d’une des photographies de Graeme Williams. Est-ce quelque chose que vous avez à l’esprit alors que vous développez ce projet ?
Je pense qu’il s’agit là d’une question importante. Il est bien sûr difficile de présenter cette œuvre au public. Nous touchons ici à de nombreuses questions de pouvoir, ce qui est associé à l’idée de re-contextualiser des images dont beaucoup considèrent qu’elles sont issues d’une culture non dominante.
Je ne vois pas ce projet sous cet angle, bien que je sois conscient des complexités de ce dernier et des critiques possibles à cet égard. Les images, auxquelles je confère une « valeur historique », ont été exportées en Grande-Bretagne où elles resteront jusqu’à nouvel ordre, ce qui participe à priver les Nigérians de leur culture. Cela ressemble à une démarche colonialiste, non ? À cela, il n’y a pas de réponse directe, les mécanismes du colonialisme sont extrêmement complexes. Dans mes projets artistiques, je fais le choix d’explorer ces attributs mécanismes tout en créant des scénarios qui permettent de créer un espace pour une réflexion critique à ce propos.
Je me sens aussi en accord avec ce projet car je ne peux vraiment pas m’approprier culturellement quelque chose qui m’appartient en tant que Nigérian, quelque chose qui fait partie intégrante de mon identité et pour laquelle j’ai un vrai respect.
Ce projet escompte valoriser la culture nigériane et à le faire sous un jour positif qui, espérons-le, permettra l’échange culturel et ouvrira un dialogue avec les amateurs de photographie et ceux qui s’intéressent au portrait en studio.
Il me semble en revanche vraiment problématique qu’il faille un artiste basé au Royaume-Uni, à même d’investir du temps, de l’argent et de l’énergie, pour que ce projet puisse être vu par un public large (nigérian et international). Pendant ce temps là, au Nigeria, nous luttons pour obtenir des fonds et que le gouvernement soutienne c es projets de préservation culturelle qui bénéficieraient grandement aux Nigérians.
C’est la première fois que les images sont montrées à un large public au Nigeria. Qu’attendez-vous de cette exposition ?
J’espère que cette dernière poussera les gens à s’arrêter et à réfléchir. Quel dommage que ces images soient détruites. Je veux que le projet inspire de la fierté et qu’il stimule les Nigérians à collecter et à conserver leurs propres archives familiales. J’espère que la présentation laissera le public désireux d’en savoir plus. Ces images ont beaucoup à nous apprendre.
Qu’adviendra-t-il des archives dans le futur ? Vont-elles rester votre propriété ou pensez-vous qu’un musée devrait conserver les fonds pour la postérité?
Pour le moment, il est impossible de dire ce qu’il adviendra des archives. Les négatifs sont actuellement dans mon studio à Londres. Il y a des milliers et des milliers de négatifs. Bien que toutes les images soient potentiellement intéressantes, je m’interroge sur les limites de ces dernières. Que choisit-on de stocker et d’archiver ? Où placer la limite ? S’il est formidable de voir une image d’un homme qui tient un téléphone, avec une pose nonchalante, typique des années 1990, voir 600 hommes avec la même pose est un enjeu. Ces images, de par leur nombre, posent question quant à leur valeur. Le tri intervient à ce moment là, et c’est pour cette raison que je pense qu’un livre devrait être réalisé pour accompagner le projet, afin de rendre les images, et l’histoire, accessibles.
Nous organisons une conférence sur la notion d’archives à Lagos le 28 octobre prochain, avec la Professeure Abosede George, conversation à laquelle vous contribuerez. Pensez-vous qu’il y ait suffisamment d’archivistes au Nigeria ?
C’est un sujet qu’il faut vraiment aborder. Il est essentiel de promouvoir les artefacts historiques et culturels au Nigéria. De tels sujets doivent figurer à notre ordre du jour, et ces objets doivent faire partie d’un programme d’études plus large qui revient en somme à dire que : culture = valeur.
Pouvez-vous discuter des différents « axes » que nous avons choisis d’aborder dans l’exposition que nous présentons à Lagos (immensité, originalité et détérioration de l’archive).
Toutes les archives comprennent de multiples couches de sens et peuvent être lues de plusieurs manières différentes. Les photographies que je conserve donnent à voir la diversité des styles, ce qui paraît logique, surtout car elles s’étalent sur de nombreuses années. Il y a de nombreuses raisons qui poussent une personne à se rendre dans un studio de photographie. Par exemple, les couples amoureux veulent un souvenir de leur amour tandis que d’autres affichent leur désir de voyager (certains posent devant des décors qui dépeignent New York par exemple). L’exposition au LagosPhoto Festival ne montre qu’une sélection mais celle-ci se voulait transversale. On y voit le caractère ludique des poseurs, leurs aspirations mais on y lit aussi l’évidente détérioration des images et cela est constitutif de l’esthétique de ces archives, car les négatifs ont été laissés à l’abandon et parfois stockés dans des milieux humides. Etrangement, ce sont là certaines des images que je préfère : elles forcent le spectateur à imaginer ce qui a pu disparaître ou être effacé par l’humidité.


Y a-t-il une photo spécifique que vous gardez en mémoire ? Laquelle et pourquoi ?
L’une de mes images préférées, à ce jour, est celle d’un homme nu, couvert d’une cape. L’image est très puissante et attire évidemment le regard, de par la représentation qui est donnée du sujet. C’est une image qui oblige le spectateur à poser des questions sur le genre et la masculinité, la pureté, la beauté et la sexualité. Bien que je considère qu’il s’agit d’une image esthétiquement belle, elle est problématique et la jeunesse du personnage photographié m’amène à m’interroger sur le consentement des modèles et évidemment sur le but et le destinataire de cette image. J’ai choisi de censurer les visages pour protéger l’identité du sujet et n’ai pas encore décidé si je vais un jour montrer cette image non censurée pour des raisons éthiques.
Nous avons discuté de la question du lieu de stockage des archives photographiques et de la difficulté de les conserver au Nigéria. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Les archives se trouvent actuellement à Londres car c’est là que j’habite. Je vais parcourir les archives en prenant mon temps. Lorsque j’ai commencé ce projet, je trouvais problématique d’avoir ces images ici, à Londres, car j’avais l’impression d’enlever quelque chose au Nigéria. Cela me mettait mal à l’aise. Mon opinion a changé au fil du temps. Lorsque je réfléchis à l’état dans lequel étaient ces archives (leurs conditions de stockage initiales les soumettaient à l’humidité, la chaleur et la poussière), la question de leur emplacement actuel devient secondaire. Je préfère qu’elles soient ici au sec et à l’abri du vol plutôt que maltraitées, mais à Lagos, surtout s’il n’y a pas de désir de les préserver.
Vous considérez-vous curateur ou artiste, dans le cadre de ce projet ?
Cette fois, je me considère davantage comme un curateur. Je n’ai pris aucune de ces images moi-même, et beaucoup ont été photographiées avant même ma naissance. Elles sont le produit de photographes qui ont gagné leur vie par le biais de la photographie. Mon rôle est multiple cependant. J’étais, initialement, un archiviste, et ce par hasard, ou presque, puis, par amour pour la photographie et ne voulant pas laisser cette histoire disparaître, je me suis transformé en éditeur. Je commence un long processus de visionnage et de sélection des images. Avec le temps, je deviendrai chercheur car j’aimerais explorer ces images, savoir qui sont les sujets photographiés et leurs photographes. J’assume enfin le rôle de curateur en participant à choisir quelles images sont exposées et lesquelles sont les plus représentatives des archives.
Pouvez-vous parler de la dimension performative de la photographie de studio et de sa place dans votre propre pratique artistique ?
Le studio de photographie a toujours été un lieu d’expérimentation et de performance. Le studio fait office de scène. Certaines personnes l’utilisent comme une arène pour exprimer leurs ambitions intérieures et leur fantaisie, tandis que d’autres choisissent de faire voir leur succès, leur classe et leur sophistication, utilisant le support photographique comme un témoignage de vérité, entre reflet fidèle de leur vie ou évasion momentanée.
Je me mets aussi en scène devant la caméra et il s’agit souvent d’une identité créée, qui joue avec les limites de la réalité et de la fiction.
Pourquoi les photographies du Lagos Studio Archives n’ont-elles pas été montrées jusqu’à présent et pourquoi n’en exposer que quinze à Lagos?
Le projet n’a pas encore été présenté car il a fallu surmonter de nombreux obstacles. Tout d’abord, j’ai dû constituer une archive à Lagos, que j’ai stockée pendant un an, ensuite, il a fallu la faire transporter au Royaume-Uni, définir la meilleure manière de le présenter, et tout ceci en parallèle de ma propre pratique. Lorsque vous m’avez demandé d’exposer ce travail lors du LagosPhoto Festival, j’ai hésité car je n’ai pas encore eu assez de temps de recherche pour mener le projet comme je le souhaite. Cependant, en raison du thème du festival de cette année (Time Has Gone) et des questions qui seront abordées dans cette édition de LagosPhoto, j’y ai vu une occasion d’entamer une conversation internationale autour de l’état de nombreuses archives photographiques analogiques au Nigeria, conversation qui pourrait façonner l’avenir du Lagos Studio Archives. La sélection des quinze images est un aperçu, une exposition qui donne l’envie d’en voir plus.
Pouvez-vous parler du choix volontariste d’exposer ces œuvres en petit format ?
La décision de présenter ces pièces en petit format était une décision esthétique et en adéquation avec le genre auquel elles se rattachent. Les petits tirages engagent le spectateur et le rapprochent de l’œuvre. Le rapport à l’œuvre est plus personnel. Dans la sélection de LagosPhoto, il y a des images qui, à mon avis, seraient absolument incroyables si elles étaient imprimées en très grand format, c’est donc quelque chose que je suis impatient de voir à l’avenir. Nous n’en exposons que quinze et celles-ci sont toutes au même format afin que le public puisse se concentrer sur le contenu.
Le critique d’art américain Hal Foster considère que « tous les documents d’archives sont des ready-made mais sont construits ; ils sont liés au réel mais aussi à la fiction ; ils sont publics et privés » (An Archival Impulse, n ° 110, 2004, p. 5). Qu’en pensez-vous ?
Je pense qu’Hal Foster souligne un élément important : les archives ouvre un certain nombre de possibilités et l’artiste ou le conservateur est ainsi en mesure d’étudier et/ou de construire du sens à partir de celles-ci. Ce processus s’apparente pour moi à l’idée d’une résurrection : l’idée de ramener à la vie quelque chose qui était disparu et de recréer une histoire. Lorsqu’Hal Foster parle de factuel vs. fictif, il vise juste en ce qui concerne toute archive. La photographie peut être considérée comme un enregistrement de l’espace et du temps et peut donc être considérée comme un art du « factuel » ou du « réel » et pourtant ce qui est inclut dans le cadre est ouvert à l’interprétation. Le médium est donc aussi proche de la fiction que du réel. Travailler sur ce projet m’a obligé à vraiment prendre en compte la manière dont toutes les archives sont aussi « publiques que privées ». Ce fond regorge de photographies intimes et je me demande constamment pourquoi et si ces images doivent être montrées au public. Je remets constamment en question les limites entre le domaine public et la sphère privée et cela restera, je pense, l’une des questions essentielles pour le futur de ce projet.

Les documents et archives font de plus en plus souvent leur entrée dans l’espace muséal, et particulièrement dans le monde de l’art contemporain. Avez vous des photographes / collectionneurs / curateurs qui vous ont influencé dans cette pratique de collectionneur-artiste ? Nous avons évoqué ensemble le travail de l’artiste libanais Akram Zataari, dont l’exposition a ouvert récemment au Centre d’art contemporain de Cincinnati où je travaille, et les similitudes entre vos deux projets. Est-ce que son Institut est un modèle pour les Lagos Studio Archives ?
Je pense que le document d’archive fait depuis longtemps partie de l’art contemporain, mais peut-être a-t-il été utilisé différemment jusqu’à présent. Les artistes d’aujourd’hui utilisent les archives pour contester l’idée de propriété et de droit d’auteur et s’approprier ces dernières pour en donner un sens nouveau. Il s’agit bien sûr d’un jeu risqué, car une telle appropriation peut fausser « l’intention » ou la perspective « originale » de l’archive et donc de la réalité.
Je me suis toujours intéressé aux archives, notamment les albums de famille ; la photographie vernaculaire comme les objets personnels. Je suis curieux de savoir où de tels objets du passé peuvent atterrir dans le présent et comment ils peuvent être utilisés de manière artistique pour faire un commentaire sur ce que nous vivons.
Par le biais de ce projet, j’espère rencontrer d’autres artistes qui utilisent l’archive. Akram Zaatari est l’un d’entre eux. Je suis son travail et j’adore la façon dont il re-contextualise les images et remet en question la façon dont nous considérons les archives.
Dans l’un de ses catalogues intitulé Against Photography, Akram distingue les fonds photographiques privés à ceux des photographes professionnels. Il explique que ces derniers donnent à voir des motifs récurrents, des tendances en d’autres termes. Y a-t-il des motifs récurrents dans ces huit fonds différents que vous avez collectés, qui diraient les particularités de tel ou tel studio de photographie ou encore de tel ou tel photographe ?
Des tendances claires émergent au sein de ces fonds photographiques. Je pense au style des portraits, à la posture des sujets, et même au choix des accessoires et des arrière-plans utilisés par chaque photographe. L’esthétique générale du portrait de studio est en réalité régie par la même reproduction de tendances populaires et la satisfaction de certains sujets par rapport à leurs modèles ou à leurs aspirations profondes. Etant donné que l’art de la photographie de studio était un art marchand (la photo s’échange), le sujet photographié éprouve le besoin d’imiter et de reproduire certains modèles, et cela devient une partie essentielle de l’appréciation de l’expérience en studio. Si le studio possède un fond peint de Londres, la possibilité de se représenter avec cette toile de fond devient un argument de vente pour le studio. Afin d’attirer plus de clients, un studio concurrent va alors choisir non seulement un arrière-plan londonien mais, mieux, introduire un fond new-yorkais. Les autres motifs récurrents sont liés au choix des accessoires et des poses adoptées. Les fleurs sont probablement l’accessoire le plus usité de l’histoire des studios : un accessoire « naturel » mais qui a souvent tout de l’artifice. Un autre accessoire qui a une place essentielle dans la photographie de studio est le téléphone. La ligne téléphonique est bien entendue coupée, le téléphone n’étant pas branché, mais ce besoin d’exprimer l’idée de communication et de progrès est un motif récurrent dans la photographie de studio du monde entier.
En ce qui concerne les poses, certaines personnes choisissent de reproduire celles qu’ils/elles ont vues dans d’autres studios, participant ainsi d’une répétition et d’un archive universelle. La main sur le menton est devenue un motif car la pose évoque le penseur, un attribut intellectuel que beaucoup voulaient s’attribuer devant la caméra, tout comme le regard tourné vers le lointain. Tous renvoient à la façon dont les gens aiment être représentés.
Cependant, et bien qu’il y ait des récurrences, c’est le modèle qui fait l’image. Son choix vient souvent briser la configuration banale du studio. Qu’il s’agisse de gestes, de posture, ou de mises en scène plus élaborées, quelque chose vient presque toujours créer la surprise. Si les Nigérians suivent la mode et reproduisent ainsi des codes globaux, ils ont un style et un humour très distinctif. J’ai donc hâte de découvrir, au sein des Lagos Studio Archives des images qui viendront rompre de manière radicale avec les attentes que j’ai et que nous avons de ce qu’est la photographie de studio.