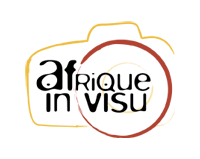Sofia Yala Rodrigues est une artiste plasticienne basée entre Lisbonne et Brighton. Elle a un intérêt particulier pour les histoires personnelles, les fragments coloniaux et la diaspora.
A travers cette interview, nous revenons sur sa pratique artistique liée à l’utilisation des archives et la façon dont elle incorpore sa propre identité individuelle et familiale comme point de départ pour une réflexion sur des questions de mémoires collectives.
Peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ?
Je m’appelle Sofia Yala Rodrigues, je suis une artiste plasticienne basée en Angleterre et au Portugal. Ma pratique est multidisciplinaire et elle n’est pas statique. C’est une sorte d’organisme vivant qui a changé au fur et à mesure que j’évolue. C’est un travail hybride en cours qui se développe avec moi. Je me suis concentrée sur la mémoire collective, les archives et la décolonisation des récits. Mon expérience dans les arts a commencé lentement en 2015 lors de ma dernière année de licence où j’avais une matière axée sur le cinéma africain. J’ai été fascinée par la complexité et la diversité du monde de l’art africain. J’ai donc organisé un petit festival de cinéma africain à l’université avec d’autres collègues et depuis, ma curiosité s’est développée.
Deux ans plus tard, j’ai fréquenté le Hangar – un centre de recherche artistique situé à Graça, à Lisbonne, qui crée des expositions et des résidences artistiques. C’est aussi un centre d’éducation, de discussions et de conversations qui unifie les lieux géographiques, les cultures et les identités et stimule le développement de pratiques artistiques et théoriques – et qui m’amène à participer à certains des workshops. Le premier était – La photographie et le pouvoir de raconter des histoires – avec le grand Nii Obodai. Il m’a permis de me poser beaucoup de questions pour orienter mon objectif dans les arts visuels et pour savoir quel type de changement je peux représenter et vers lequel je peux me concentrer. J’étais très jeune dans le monde de la photographie, mais je voulais en apprendre davantage. La même année, j’ai participé à deux autres ateliers : Photographic Tours – Thinking the Territory et Re-imagine the Empire : Projections (anti)coloniales au cinéma.
Ces expériences m’ont motivé pour aller plus loin, à écouter et à pratiquer – et j’ai commencé à développer un travail en cours avec la photographie, les archives et les images en mouvement, qui sont les archives familiales faisant partie de ma recherche anthropologique. J’ai donc construit un portfolio avec mes photographies de Lisbonne et de Luanda et j’ai décidé de postuler pour la résidence Catchupa Factory au Cap-Vert en 2018 – et j’ai été sélectionnée. Tous les participants ont eu l’occasion de faire des recherches et des expériences tout en étant soutenus par des sessions théoriques sur des questions critiques liées à la photographie africaine contemporaine. Pendant deux semaines, j’ai été entouré de photographes d’horizons différents qui ont partagé leur sagesse avec moi. C’est à partir de ces expériences que je suis définitivement devenu l’artiste que je suis. Malgré l’importance de toutes ces résidences dans mon parcours artistique, une partie de mon travail actuel peut être attribué à l’auto-apprentissage et à l’expérimentation.


Après avoir débutée ton travail personnel au Portugal, tu es désormais en Angleterre, selon ton point de vue, l’approche de la question décoloniale est-elle très différente dans ces deux pays au niveau artistique ?
Mon travail de recherche est ma thèse pour l’anthropologie et les cultures visuelles au Portugal. Mais entre-temps j’ai commencé à m’intéresser de plus en plus à la pratique artistique, à la photographie et à l’image en mouvement, ce qui m’a encouragé à m’impliquer davantage dans des ateliers et des résidences de photographie et d’arts visuels. En conséquence, j’ai décidé de déménager au Royaume-Uni, afin d’élargir mes possibilités et d’étudier les beaux arts. Cependant, j’ai eu quelques difficultés financières au cours de ma première année et demie ici, et j’ai dû me déconnecter de mes recherches. Cette année, après plusieurs tentatives, j’ai participé pour la première fois à un atelier d’art au Royaume-Uni. Pendant tout ce temps, j’ai assisté à des expositions et vu la scène artistique britannique décoloniale en tant que public.
L’approche décoloniale dans le monde de l’art est plus développée au Royaume-Uni qu’au Portugal. Au Royaume-Uni, il existe un Centre des archives culturelles noires à Londres et un Musée international de l’esclavage à Liverpool par exemple. Il y a plus d’opportunités orientées BAME ici – quelque chose que nous devrions avoir au Portugal également afin de combler le manque de professionnels BAME dans les arts et d’élargir notre histoire inconnue. Néanmoins, il y a beaucoup à faire dans les deux pays sur le plan artistique, même si le Portugal est assez en retard sur le travail de mise en œuvre des archives noires, de décolonisation de l’éducation, de remise en cause de l’esclavage et d’ajout de professionnels BAME dans différents domaines.
Au départ ta démarche s’apparente à la recherche en anthropologie visuelle puis tu vas te tourner vers un travail plus personnelle en tant qu’artiste, pourquoi ?
Je suis titulaire d’une licence en études africaines et j’ai étudié l’anthropologie visuelle. Même si cela a commencé comme une thèse académique, au cours du processus, j’ai eu le sentiment que ces archives, documents et images avaient beaucoup plus à dire, plus que des mots, au-delà des termes académiques. Il y a donc un lien étroit avec un point de vue ethnographique dans de nombreuses couches de mon travail.
En tant que membre de la diaspora ayant des liens avec ces archives, j’ai commencé à écrire et à en apprendre davantage sur ma famille et les travailleurs maritimes – transformant ainsi cette recherche en un voyage biographique. Ce fut également une étape importante pour développer la partie théorique de la position de ma famille dans le passé colonial. C’est pourquoi il est important d’avoir un regard ethnographique et de détruire les préjugés coloniaux du domaine en prenant moi-même l’autorité de raconter l’histoire de mes ancêtres. Être anthropologue noir reste une sorte de paradoxe, en théorie, j’étais censé faire l’objet de recherches sur le thème «autre», alors que maintenant je suis le chercheur lui-même.
C’est pourquoi il est important d’avoir un regard ethnographique et de détruire les idées préconçues coloniales du domaine en prenant moi-même l’autorité de raconter l’histoire de mes ancêtres.
Jusqu’à présent, j’apprends à élargir la multiplicité des manières d’exprimer l’histoire et la mémoire collective par la création visuelle, car c’est ainsi que je peux naturellement partager des histoires globales avec une perspective décoloniale.


Tu interroges la notion de mémoire collective, d’identité en explorant tes archives familiales, peux tu nous en dire plus sur ta démarche ? Et revenir sur ta manière de créer une nouvelle narration, avec quels outils ? Comment active-t-on des archives ?
Pendant plusieurs années, j’ai entendu les histoires de ma famille, en transmettant également des expériences d’autres familles angolaises, créant une sorte de récit partagé. Ces histoires, dont certaines ont plus de 50 ans maintenant, bien avant l’indépendance, étaient toujours racontées dans un cadre informel. J’ai vécu avec mon grand-père du côté de mon père, et j’ai eu l’occasion d’écouter son passé et ses voyages, qui sont décorés avec les portraits de groupe et les objets de son travail et de nombreux autres objets ménagers qu’il avait rassemblés en chemin. Il parlait toujours de ses expériences avec une certaine appréhension et de manière très simplifiée, à la suite des innombrables incarcérations dont lui-même, ses collègues et les membres de sa famille avaient été soumis. Depuis, je m’interroge et j’imagine ces voyages et les difficultés que ces hommes, mon grand-père et ses collègues de travail, ont traversé, tant au Portugal qu’en Angola.
Ma compréhension de la mémoire collective a véritablement commencé alors, chez moi, en écoutant ces récits familiaux de résistance, assis à la table à manger. Cependant, je ne pourrais pas parvenir à une telle compréhension des travailleurs maritimes et de leurs familles sans le livre « Marítimos Africanos e um Clube com História » (2005) de Filipe Zau. Historien et sociologue angolais, il rassemble les rares témoignages de trois générations de professionnels d’origine africaine de la marine marchande portugaise. Cette remarquable recherche m’a donné des réponses que je n’atteindrais jamais moi-même, et la mémoire collective de ces groupes est déjà réduite puisque beaucoup d’entre eux sont âgés et que d’autres ne sont plus parmi nous. Comme je l’ai déjà mentionné, mon grand-père était assez discret en termes de détails, et j’étais trop jeune pour tout comprendre C’est pourquoi ses recherches (celles de Zau) ont donné un élan essentiel à mes recherches dans les archives familiales. En attendant, j’ai commencé à lire Paul Gilroy, Stuart Hall, Kobena Mercer et en visualisant le travail de John Akomfrah, tout s’est réuni et j’ai réalisé à quel point le lien est vital et robuste entre la mémoire, la décolonisation de l’histoire et les arts visuels.
Mon approche de l’activation des archives se réfère à une histoire individuelle qui fait partie intégrante de l’historiographie portugaise et angolaise. Mon travail se matérialise dans un récit simple, par des collages et des photographies, les échos d’une petite-fille d’anciens ouvriers maritimes, intégrant la molécule de l’histoire «non officielle». À l’époque fasciste au Portugal, de nombreux témoignages de ces travailleurs ont été vidés de leur substance dans le vide du silence, beaucoup d’entre eux ont été emprisonnés pour avoir transporté des informations clandestines telles que des documents, des journaux, des poèmes ou des messages contre l’État colonial et pour avoir soutenu la libération du peuple. Dans la lignée de la pensée de Paul Gilroy dans Black Atlantic (1993), le navire est un lien essentiel entre les identités diasporiques et un médiateur de leurs mémoires collectives :
«L’image du navire – un système micro-culturel et micropolitique vivant
en mouvement – est particulièrement important pour des raisons historiques et théoriques
(…). Les navires attirent immédiatement l’attention sur le passage du milieu, sur les différents projets de retour rédempteur à une patrie africaine, sur la circulation des idées et des militants ainsi que le mouvement d’artefacts culturels et politiques clés: tracts, livres, gramophone, disques et chœurs »[[GILROY, Paul. L’Atlantique noir: modernité et double conscience . Presses universitaires de Harvard, 1993.]] (Gilroy, 1993, p. 4)
Peux-tu nous parler du Club maritime africain et des travailleurs maritimes ? Pouvez-vous nous parler de l’African Maritime Club et des travailleurs maritimes ?
En raison de la détérioration des conditions de vie des autochtones et du manque d’accès à l’éducation pour les enfants noirs angolais, mes grands-parents ont décidé de déménager au Portugal et d’emmener leurs enfants avec eux avant l’indépendance (1975). Cela vaut pour les deux côtés de ma famille, le côté maternel et paternel, les Yala et Rodrigues.
En raison du manque de main-d’œuvre portugaise disposée à travailler dans des situations physiques difficiles et particulièrement stressantes et dangereuses, les entreprises de la marine portugaise ont commencé à accepter progressivement des travailleurs africains comme aides de cuisine, serveurs, équipe de blanchisserie et pour les sections machines à bord des navires. Servir ces entreprises qui traversent l’Atlantique représenterait certainement une expérience vraiment terrifiante, non seulement par la vertu du travail, mais aussi en raison de la grave discrimination raciale. Cependant, c’était la seule façon de sortir de l’atmosphère coloniale. La possibilité de mobilité est venue offrir à la plupart de ces travailleurs maritimes la possibilité de faire venir leur famille au Portugal ou dans d’autres pays européens.
La coexistence entre les résidents africains au Portugal et les immigrants récents, étudiants et travailleurs du centre de Lisbonne, a stimulé et développé une organisation appelée The African Maritime Club. Cette association a commencé comme un petit groupe sportif et d’étude pour une vue d’ensemble des possibilités et des outils nécessaires à la libération des colonies. Ces travailleurs ont joué un rôle important dans le partage d’informations interdites du Portugal vers les pays africains et le reste du monde par voie maritime.

Peux tu nous parler de tes deux projets « Tapez ici pour rechercher » et « Album de Auntie à Luanda » ?
L’album de ma tante à Luanda est le facteur de changement dans mon parcours, quand j’ai réalisé qu’entrer dans les archives familiales est un chemin auquel on se consacre pleinement. Ces questions d’identité, d’histoire et généralement à la recherche de réponses pour le passé, ont toujours été présentes depuis que j’ai commencé à rechercher davantage d’archives, de portraits, de cartes postales, de billets et de contrats de travail auprès des entreprises de la marine. Je me suis retrouvée avec tellement de questions, auxquelles ma famille ne pouvait pas répondre, qu’elles ont progressé vers ce qui est maintenant « « Type here to research »». Ce projet est une narration de mon processus de découverte de la réalité des travailleurs maritimes et de leurs familles et de sa reconstitution à travers des expériences avec des collages.
Cette pratique autour des archives familiales se retrouve à travers plusieurs approches d’artistes du monde entier, comme Carolle Benitah, Irene Reece et aussi au Portugal avec Monica de Miranda, comment ces histoires personnelles rejoignent-elles l’histoire nationale ou internationale ? Pourquoi cet intérêt pour les images d’archives ?
Au départ, je craignais que mes archives personnelles ne servent que ma propre identité et que cette histoire elle-même soit assez individualiste. Alors que c’est exactement le contraire, comme vous l’avez mentionné, ces histoires personnelles rejoignent l’histoire nationale et internationale. Ces morceaux du passé qui restent dans nos foyers sont notre langue et notre expérience communes. Nous racontons nos propres histoires, ce qui est nécessaire, afin de mettre l’histoire «non officielle» au premier plan et de se demander pourquoi elle a été marginalisée pendant tant d’années. La scène artistique coloniale est encore très particulière en termes de qui a le pouvoir de partager des récits et comment. Les artistes que vous avez mentionnés ont réussi à rapprocher l’expérience nationale de la scène internationale. Dans l’ensemble, il s’agit de repousser les limites dans différents formats mais avec le même objectif, éclairer des sujets inconfortables ou urgents tels que la race afin d’élever les communautés noires et brunes, en utilisant des images d’archives.
Quels sont tes projets dans le futur ?
Eh bien, je viens d’être sélectionné pour deux formations, l’une est une maîtrise en arts: cinéma et photographie à l’Université de Derby, et l’autre est un projet indépendant de la publication des Editions Essarter. Notre travail portera sur le conflit entre deux voies migratoires vers l’Europe occidentale, l’une en provenance de l’Angola et du Portugal, l’autre en provenance de l’Arménie et de la Bulgarie. En déconstruisant nos recherches et nos positions respectives en tant que migrants contemporains, nous explorerons des sujets d’idéologies non hégémoniques, de post-colonialisme et de post-communisme. La publication se concentre sur la connexion des régions de l’Europe de l’Est, de l’Europe de l’Ouest et de l’Afrique grâce à la recherche scientifique et théorique et à la création d’images. A l’avenir, j’aimerais travailler en collaboration avec plus d’artistes afin de créer un réseau et partager des expériences.

Picture from Auntie’s album in Luanda « Paquete Angola ».
Family Yala on the way to Portugal

Picture from Aunties Album in Luanda « Paquete Angola »
Grandfather at work