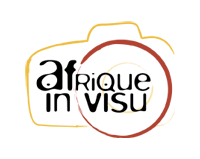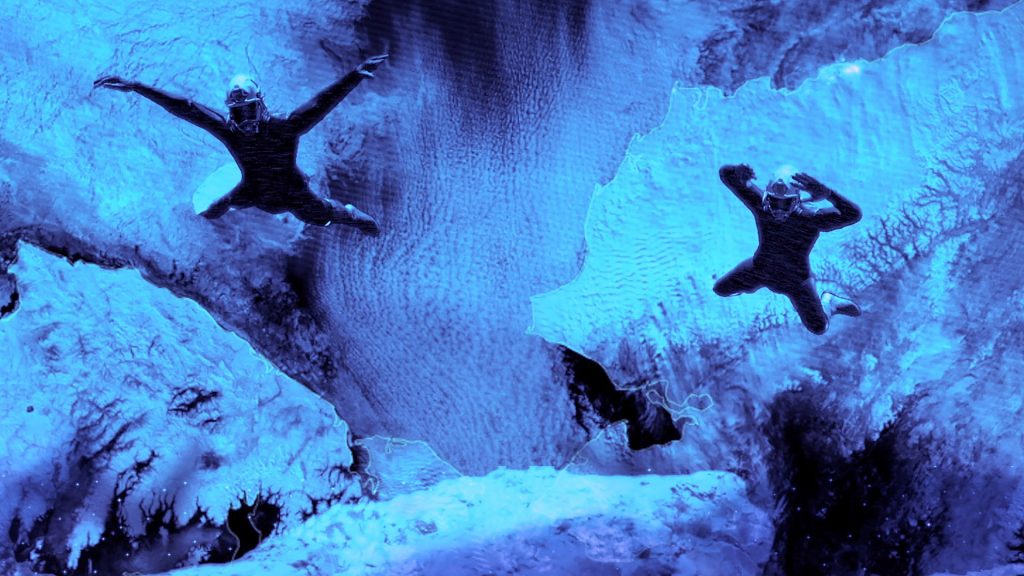Une exposition vient de se clôturer. Rwanda, des photos pour le dire, un projet photographique, vidéo et sonore, d’Anaïs Pachabezian, exposé jusqu’au 30 novembre 2014 au Centre Emmaüs Louvel-Tessier dans le cadre du Festival des Nouveaux Cinémas Documentaires #4, organisé par l’association Belleville en Vus. Dans cet entretien, elle nous raconte son histoire, ses liens avec le Mali et le Rwanda…..
**Peux-tu te présenter : quelle photographe es-tu ?
Je fais de la photographie depuis l’adolescence. Quand il a fallu choisir une voie après le Bac, j’ai suivi une filière scientifique mais ça ne m’intéressait pas vraiment. J’ai décidé d’étudier la photographie à Paris VIII. L’université, c’était très théorique; j’ai donc commencé à faire des stages, pour apprendre vraiment. J’ai passé quatre mois à l’Agence Vu au cours d’un stage très instructif. Puis un mois au service photo du quotidien L’Humanité et un mois au sein du collectif de photographes le Bar Floréal où j’ai finalement été engagée pour un CDD de quelques mois : c’était mon premier job. Je faisais plusieurs choses : des recherches iconographiques principalement, mais j’ai également suivi les projets collectifs des photographes et de la galerie… C’était formateur mais assez frustrant car je ne faisais pas de photo. Je me suis dit : à mon tour.
J’avais développé un intérêt pour le Mali après un premier voyage en Afrique de l’Ouest. Je suis donc partie quatre mois entre le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal avec le projet de rencontrer des artistes plasticiens. J’ai fait de très belles rencontres surtout au Mali. Et le travail de portraits qui en a résulté a été présenté à Bamako lors de la rue photo du Off de la Biennale de Bamako en 2001 à la demande de Chab Touré qui en était l’organisateur. A cette époque, je travaillais comme iconographe pour un magazine en France, et j’avais dû rentrer un peu précipitamment ; mais l’envie de repartir était très forte. Je suis donc repartie début 2003 pour trois mois au Mali qui se sont transformés en une année. J’ai vécu une expérience forte, faite de très belles rencontres qui m’ont marqué. J’ai pris beaucoup de photographies à cette période, principalement en noir et blanc, argentique bien sûr. Je n’ai encore jamais montré ce travail et l’envie ne naît que maintenant ; je suis en train de réfléchir à la forme que cela pourrait prendre…
Suite à ce long séjour, j’ai décidé de me professionnaliser en tant que photographe et de revenir en France. Je m’intéressais de près au reportage et à la photographie documentaire. J’ai donc décidé de suivre une formation professionnelle en photojournalisme qui m’a servi principalement à me lancer. Et là, j’ai commencé à réaliser des reportages sur la communauté malienne en île de France, avec notamment un travail sur les griottes maliennes en exil à Paris. J’ai été introduite dans ce milieu par Oumou Kouyaté, elle-même griotte, que j’ai photographiée dans des baptêmes, des mariages et autres événements. Le travail qui en est sorti n’a malheureusement jamais intéressé la presse et a été assez peu diffusé.
J’ai ensuite mené un projet de longue durée, toujours entre la France et le Mali, avec Anzoumane Sissoko, un sans-papier malien vivant en France depuis treize ans. C’était en 2005 et on parlait beaucoup moins de l’immigration et de la situation des sans-papiers qu’aujourd’hui : je voulais mettre un visage sur ce mot de « sans-papier ». J’ai suivi Sissoko à Paris, puis je suis allée dans sa famille au Mali, et, suite à sa régularisation, je l’ai accompagné dans la préparation et dans le voyage de son « retour au pays » qui est un passage obligé pour tout migrant de cette région. Ce sujet était très fort pour moi et a reçu un bon accueil dans la presse.
Dans le même temps, j’ai été bénévole pour l’association « Autremonde » où j’intervenais dans des ateliers socio-linguistiques pour un public de travailleurs migrants hébergés en foyer. Je leur ai alors proposé un projet retraçant le parcours d’un migrant, entre Kayes (Mali) et Paris. Le projet s’est articulé autour d’ateliers photographiques et d’écriture au cours desquels des jeunes des foyers de travailleurs d‘un côté racontaient leur quotidien, et des jeunes kayésiens de l’autre, étaient allés rencontrer des migrants. Le résultat de ces ateliers ainsi que mon propre travail photographique ont fait l’objet d’une installation et d’évènements (projection, débat, spectacle) à Paris, à Kayes et à Monéa, le village d’origine d’Anzoumane Sissoko. Ce fût vraiment un bel événement.
**Le Mali a pris une grande place dans ta vie ; comment en es-tu venu à t’intéresser au Rwanda ?
Le Mali est définitivement une partie de ma vie. Entre 2007 et 2009, j’y ai à nouveau fait de longs séjours, de sept à huit mois de l’année là-bas ! Le Rwanda est aussi là depuis longtemps. J’avais dix-huit ans en 1994 et j’ai vécu le génocide à travers les images diffusées à la télévision. Ça m’a marqué. Quelques années après, j’ai voulu en savoir plus, et je me suis mise à lire, à me renseigner. J’ai assisté à une représentation de « Rwanda 94 » du Théâtre du Groupov à la Villette, qui m’a beaucoup marqué. Puis je suis tombée sur le livre d’Esther Mujawayo et Souad Belhaddad, « Survivantes » ; Esther est elle-même rescapée et psychothérapeute. Ce livre m’a bouleversé. Mais je crois que je n’étais pas encore prête à me confronter à cette histoire… J’ai poursuivi mon travail sur les migrants en transit au Maghreb, puis j’ai passé du temps en Algérie où j’ai finalement réalisé un travail de témoignages sur la « décennie noire », en photographiant et retranscrivant les paroles d’algériens qui avaient eu un proche assassiné ou disparu. Ce travail a été édité en Algérie par les éditions Barzakh dans un livre, « A fleur de silence » et il a malheureusement été très peu diffusé, peut-être à cause de la complexité de cette période et des rapports entre la France et l’Algérie. Si j’étais allée au Rwanda avant, c’est peut-être sous cette forme que j’aurais mené mon projet. Mais, au fond la même question m’a animé à travers ces deux projets : comment fait-on pour vivre après un tel traumatisme ?
**Une question qui t’a amené certainement au projet « Rwanda des mots pour le dire »…
Oui, effectivement, et je crois que je me suis sentie prête à y aller seulement en 2013, après avoir vu deux fois la pièce « Hate Radio ». C‘est à cette occasion que j’ai rencontré Assumpta Mugiraneza qui organisait et animait des rencontres après les représentations de la pièce. J’ai fait une autre rencontre importante également avec Nathan Réra qui a écrit un livre issu de sa thèse sur les images prises pendant et après le génocide. Ces rencontres m’ont beaucoup aidé à faire avancer ma réflexion, même si, au départ, je ne savais pas comment aborder le sujet. Je n’avais pas envie de refaire un travail autour de témoignages uniquement. J’ai pris mon billet et je me suis retrouvée au Rwanda, sans projet réellement construit, avec juste l’idée de faire des rencontres. J’avais envie de rentrer en contact avec une psychothérapeute ; et c’est avec Emilienne Mukansoro que cela s’est concrétisé. Elle est psychothérapeute, spécialisée dans le traumatisme; reconnue dans son travail, elle a collaboré avec des organismes tels qu’Ibuka et Médecins du Monde. Elle-même a perdu toute sa famille durant le génocide. Elle m’a invitée à « participer » à une séance de psychothérapie collective qu’elle menait avec un groupe de femmes à Gitarama. Au cours de la séance, j’ai surtout écouté. J’ai pris quelques photos. C’était très chargé émotionnellement. Ce fût pour moi un moment très fort… Nous sommes allées ensemble chez trois d’entre elles également pour les rencontrer, les écouter. Puis je suis rentrée à Paris. Et mon projet m’a paru comme une évidence. Je voulais que les femmes participent, et construire avec elles un œuvre collective. Je ne voulais pas venir, prendre et repartir. Et Emilienne a été très réceptive à cette démarche. En fait, ce premier voyage a été un voyage de repérage…
**Quel lien fais-tu entre le travail de psychothérapie et le fait de proposer à ces femmes (que tu as photographié également) de passer derrière l’appareil ?
Je tiens d’abord à préciser que la semaine d’atelier ne s’est pas faite dans un cadre médical. Ce n’était pas des séances de psychothérapie ; peut-être quelque chose proche de l’art thérapie… Pour tenter d’être plus claire, je dirais que le premier objectif n’était pas le processus de psychothérapie, mais bien la réalisation d’une œuvre collective. Permettre à des femmes rescapées du génocide des Tutsi au Rwanda de prendre des photographies, d’être elle-même actrice d’une production artistique et d’avoir la possibilité de porter un regard sur leur propre histoire passé, présente et future. Mais il est indéniable qu’après l’atelier, nous nous sommes toutes rendues compte de sa portée psychothérapeutique que ce soit les participantes qui l’ont clairement exprimées, Emilienne ou moi-même.
Sur des projets précédents, j’avais toujours pensé les ateliers, et mon projet personnel en tant que photographe, de manière séparée. C’est la première fois que je pensais les deux ensembles comme la seule façon possible de traiter ce sujet et pour réaliser une œuvre dont toutes les parties sont indissociables les unes des autres.





**Peux-tu décrire un peu le processus et le déroulement de cet atelier ?
Emilienne a proposé à dix femmes qu’elles connaissaient dans le cadre de ces groupes de psychothérapie collective de participer à cet atelier. Pour être franche, je ne sais pas trop comment elle les a sélectionné, elle a géré elle-même cet aspect. Nous avons fait cinq jours d’atelier, assurant les repas et les perdiems des participantes. Je leur ai proposé de travailler sur trois temps ou thèmes : le passé / le présent / le futur. Et nous avons essayé avec Emilienne de les aider à comprendre comment nous allions travailler en photographie. Elles sont cultivatrices pour la plupart, et n’ont pas l’habitude de prendre des photos. Au départ, c’était donc un peu flou pour elles. Notamment plusieurs se sont interrogées sur comment photographier le passé ? Mais elles ont finalement compris très vite le but de l’atelier et en ont saisi l’enjeu. Nous avons débuté par un temps de paroles autour des objets qui leur évoquaient le passé, puis elles les ont amenées. Là, elles ont décidé ou non de les mettre en scène et de les photographier. Il y avait cinq appareils à disposition, donc tout ce travail de prise de vue a été très collaboratif.
Ce qui a été compliqué pour moi, c’était de mener l’atelier et de le documenter en même temps. Je faisais des prises de son, des photographies et je filmais aussi. L’intégralité des ateliers a été enregistrée et traduit par Emilienne, c’est la trame de toutes la voix off du diaporama sonore qui est une partie intégrante de l’installation.
Pour photographier le présent, elles rentraient chez elle avec un appareil photo le soir, après l’atelier et revenaient avec le lendemain matin. La seule consigne était de prendre des photos qui avaient du sens pour elles et elles l’ont parfaitement compris. Certaines ont pris en photo leurs enfants, leurs maisons, leurs champs… Les photos étaient regardées dès le lendemain avec un temps de prises de parole. Elles ont pris des photos de leurs quotidiens en y intégrant des choses du passé, sans que ça leur soit demandé. Certaines sont retournées dans des lieux où elles avaient été durant le génocide… Elles ont recréé des situations parfois, comme l’une d’entre elles qui est allée dans un fossé où elle avait été ensevelie sous des cadavres en 1994, et elle s’est prise en photo en train d’en sortir, facilement et librement cette fois-ci.
J’ai fait leurs portraits au milieu du parcours. Et pour l’exposition, chaque portrait est accompagné d’un texte tiré de leur présentation au premier jour de l’atelier. Certainement que la première femme qui avait parlé alors a initié une manière de se dire, et que par la suite, toutes les autres ont repris ce « j’aime / j’aime pas » ! Surtout à propos de l’alimentation ! Je ne sais plus vraiment comment ça s’est fait, mais j’ai trouvé que c’était une belle façon de se présenter.
Nous avons abordé le thème du futur le 4ème jour. Je voulais que ce temps de prise de vue se fasse à l’extérieur, dans un autre endroit que là où avait eu lieu l’atelier. Nous avons trouvé un lieu calme et beau, un endroit en plein milieu de la nature, prêté par un propriétaire privé. A nouveau, nous avons d’abord laissé place à la parole, puis elles ont pris de photos de cet endroit.
Enfin j’ai passé du temps avec Emilienne à Gitarama. Je voulais retourner voir quelques unes de ces femmes, photographier et filmer leurs quotidiens à travers mon regard cette fois-ci, pour apporter un autre éclairage au projet. J’ai pu le faire avec deux d’entre elles, à défaut de temps. Lors de mon premier séjour, j’avais également pris quelques photographies chez certaines d’entre elles et que l’on retrouve dans l’installation.
Après avoir imprimé une centaine de photos, Emilienne et moi avons organisé une séance de restitution avec une installation qui réunissait chaque temps (passé, présent, futur) pour chacune d’entre elles. Elles sont reparties avec leurs photographies en mémoire de ce travail fait ensemble.
https://vimeo.com/111734879
**Comment as-tu pensé l’exposition ?
Je voulais revenir sur ces trois temps. Le passé est présenté dans une première salle, avec les photos et les textes imprimés sur une boîte. Ensuite le présent, dans une autre salle, sous forme de diaporama sonore. Là, une voix off dit des extraits de textes que nous avons écrits avec Emilienne à partir de ce qui s’est dit pendant ses cinq jours d’ateliers. Et enfin le futur, avec quelques photographies de paysages et des textes. Les portraits des femmes, leurs présentations, ainsi que des photographies que j’ai prises chez certaines d’entre elles, et quatre vidéos viennent compléter le dispositif. Je voulais que cette installation retrace l’expérience de l’atelier, raconte par bribes leur vie et fasse entendre des voix intimes et actuelles sur ce génocide contemporain. C’est un tout qui ne peut être présenté qu’ensemble, composé de leurs photos, des textes extraits de leurs paroles, leurs portraits, mes photos et vidéos.


**As-tu eu des retours déjà depuis le vernissage ? Comment vis-tu toi cette installation ?
Pour moi, ce projet est vraiment un aboutissement.
Les retours ont été très positifs pendant le vernissage. Mais j’aurais dû t’amener le livre d’or, tu aurais lu par toi-même… je crois que l’installation est assez complète et permet de bien rendre compte de ce projet.
Quelques personnes m’ont demandé pourquoi je n’avais pas laissé un fond sonore aves les voix de ces femmes en kinyarwanda. Ça me semblait un peu compliqué… et je ne voulais pas que leurs paroles soient lues en sous-titre, je voulais qu’elles soient entendues et que les photographies présentes à l’écran prennent toutes leurs places. Dans les vidéos, on entend leurs voix, elles sont présentes par ce biais-là.
**Souhaites-tu donner suite à ce projet, ou en as-tu de nouveaux en tête ?
Les femmes qui ont participé voudraient que je revienne pour animer d’autres ateliers similaires avec d’autres femmes. En effet, les femmes avec qui j’ai travaillé ont toutes témoignées que cet atelier leur avait permis de prendre de la distance, notamment par rapport à des choses vécues, de prendre conscience également de ce qu’elles avaient aujourd’hui, ce sur quoi elles pouvaient compter et ce dont elles pouvaient être fières.
Je serai intéressée pour effectivement en refaire, avec un autre groupe de femmes, ou peut-être avec un autre type de public comme les enfants issus des viols. Nous en parlons avec Emilienne, mais rien n’est encore fait. Il faut remonter un projet, trouver des financements, etc.
Et cela ne prendrait peut-être pas exactement la même forme.
Avec un autre atelier, ce serait peut-être également l’occasion pour Emilienne de réfléchir un peu plus sur comment elle peut intégrer la photographie dans le processus psychothérapeutique qu’elle mène et de l’accompagner.
On a pensé à exposer ce travail là bas, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée : c’est un travail très intime… Selon Emilienne, certaines femmes accepteraient, d’autres pas. On verra, mais j’ai certaines réticences.
J’espère que cette installation pourra être remontrée dans un autre cadre que celui du FND#4. J’aimerais également travailler sur un projet d’édition qui rende compte d’une manière encore différente de ce projet.
Par ailleurs, je continue à tourner toujours autour de ma propre histoire, et de thématiques qui me sont chères, les migrations, l’exil et les violences faites aux femmes. Et, je m’intéresse de plus en plus à la forme du film documentaire vers laquelle j’ai très envie d’aller…
Pour aller plus loin :
– Le site d’Anaïs Pachabezian
– Le programme complet du Festival