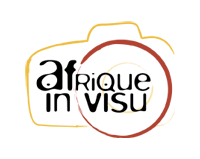C’est en préparant l’exposition Africa Is No Island qui ouvre au MAACAL à Marrakech le samedi 24 février, que nous avons découvert le travail de Walid Layadi-Marfouk. Othman Lazrak, président du MACAAL, nous avait fait parvenir son premier travail : Riad. Dans cette série, l’auteur nous conte son Maroc. Les images mentales qui surgissent quant à l’évocation du nom de ce pays sont souvent nourries de fantasmes orientalisant. Partant de ce postulat, le photographe, par ses mises en scènes, en prend le contrepied. Il rejoue un passé, celui conté par ses grand-parents, celui de son enfance et dresse, par ricochet, un portrait de l’aristocratie marocaine.
Peux- tu nous parler de ton parcours ? Comment en es-tu venu à la photographie ?
Je suis né à Paris et j’ai grandi entre Paris et Marrakech, d’où ma famille est originaire. Après avoir passé une partie de mon lycée à New York, j’ai décidé de retourner aux États-Unis pour l’université. Je me destinais à faire des études d’ingénierie, des mathématiques plus précisément, et j’ai pris un cours de photographie par hasard pour satisfaire un prérequis (il est fréquent dans les liberal arts colleges de devoir toucher un peu à tout avant de se spécialiser. D’ailleurs, j’ai aujourd’hui un double diplôme photographie/ingénieur.). Mon professeur, Jeff Whetstone, nous a fait découvrir une photographie d’un autre temps, avec une machine absolument incroyable, la chambre 4×5, et je suis tombé amoureux de la pratique. Avec le recul, cela fait sens, même si le hasard a eu un rôle très important – j’aurais tout aussi bien pu choisir un cours de peinture ou de littérature. J’ai toujours eu une pulsion créatrice, quelle soit physique, littéralement une construction, ou moins concrète, sous des formes narratives par exemple, et dès le plus jeune age je tirais mes parents pour aller au théâtre, au cinéma, au musée etc. Mais jusqu’à ce cours de photo, il me manquait une véritable raison de créer, une vraie motivation, sincère, intime, et je n’avais pas non plus d’outil à travers lequel créer quelque chose de cohérent. C’est le second qui m’est venu en premier lieu. La physique, la science optique de la chambre 4×5 m’a immédiatement séduite. C’est un appareil qui est extrêmement simple, une technologie rudimentaire, qui s’efface pour permettre de créer—de construire—des images d’autant plus complexes, précises, immersives. La suite, c’est le reste de mon parcours à Princeton qui me l’a apporté. Ma rencontre avec Deana Lawson notamment, qui était ma Directrice de Mémoire, a été décisive, et m’a permis de comprendre ce qui m’importait le plus, ce que j’avais besoin de dire.
Parlons de ta série « Riad », comment est elle née ?
Tout à commencé à l’été 2016, après la lecture du numéro spécial du New York Times Magazine entièrement dédié à l’histoire des conflits au Moyen-Orient, depuis le milieu du 20ème siècle. Le travail journalistique et de synthèse qui y était présenté est titanesque et brillant, mais ce sont surtout les photographies qui l’accompagnent qui ont retenu mon attention. Les clichés du photo-journaliste Paolo Pellegrin, n’y dépeignent que des scènes de violence, de tragédie et de souffrance, en noir et blanc. On y trouve nombre de femmes, presque toujours assises, résignées — quant leur visage n’est pas intégralement couvert — priant, forcément à proximité de décombres. Ces photos ne montrent que la désolation, et en cela, elles sont absolument représentatives de l’état actuel de l’image des cultures Islamiques, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord au sein de nos sociétés occidentales, et notamment ici, aux États-Unis. L’américain moyen, lorsqu’on lui demande de penser l’Islam, n’a qu’une seule image en tête : soit celle du 11 septembre, soit — et ce n’est pas mieux — celle d’une silhouette sombre, rachitique, voilée, prostrée quelque part dans un désert ou un bâtiment en ruines. Les attitudes actuelles de peur et de défiance en Occident envers le Moyen-Orient, le Maghreb… sont la conséquence d’une exposition à travers les médias exclusivement confinée aux pires extrêmes, à une réalité très partielle. C’est en réaction à ce constat que j’ai compris quel pouvait être mon rôle et celui de « Riad ».

Tu habites aujourd’hui aux États-Unis et dans cette série tu reviens à Marrakech, ta ville d’origine. Tu y montres une vision décalée et intime. Qu’as tu souhaité explorer ?
Constamment, chaque jour je me pose la question de ma légitimité, du haut de mes 22 ans, à discourir sur des sujets aussi complexes que ceux des représentations de cultures entières. Même si j’ai passé des mois à m’éduquer sur le sujet – et notamment sur la représentation des femmes – il y a évidemment énormément de personnes plus éduquées que je ne le suis et qui ont sûrement des opinions plus réfléchies sur le sujet. Une fois ce constat établi, puisqu’il m’est néanmoins important d’exprimer mon sentiment d’inadéquation entre la représentation et le réel, et plus important encore de tenter d’y remédier, la conclusion s’impose.
C’est à travers ma réalité du Maroc, de Marrakech, celle de mon enfance, de ma famille et, à travers son histoire — mon histoire — que je peux et dois apporter de la diversité à un modèle centré sur des images trop souvent anonymes de douleur et de misère.
En développant un langage pictural, une syntaxe visuelle qui me sont profondément propres, en représentant des membres de ma famille que je connais intimement et qui me sont chers, une femme qui compte plus que tout pour moi, dans le lieu familial séminal, je replace leurs individualités au cœur de la représentation. D’ailleurs, le titre même de la série, Riad, évoque cela. Le monde du Riad est autonome, c’est une île singulière, un prisme qui ne prétend jamais se substituer aux photographies de Pellegrin, mais qui permet – de par son excès à certains égards – de nuancer la conversation, d’en changer le centre de gravité, de modifier le stéréotype « par défaut »… en soi, de percevoir un fragment du Maroc tel que je me souviens l’avoir perçu, et tel que je crois continuer à le percevoir.
Il y a un côté très performatif, mis en scène, qu’apporte-t-il ? Est ce un moyen de dépasser les limites narratives du photo reportage ? Peux tu nous expliquer ce que cela te permet de questionner et pourquoi ?
Quelque part dans l’histoire récente des cultures de l’Islam et de leur portrait dans les médias occidentaux, une vague uniformisante, en noir et blanc, d’images de douleur, de violence, de pauvreté, de soumission… a remplacé toute autre forme de représentation qui se voudrait moins manichéenne — notamment aux États-Unis, encore une fois. Des siècles riches de prouesses artistiques sont quotidiennement effacés, réduits à néant — ils ne peuvent pas être reconnus, puisque ces images occupent tout l’espace — par une tradition picturale contemporaine trop simplificatrice.
Une simple correction factuelle ne peut suffire à modifier l’ethos occidental — après tout, il existe une pléthore de documentaires, d’expositions etc. qui attestent déjà d’une réalité si différente. C’est à travers la représentation même que le combat doit se mener, il faut arriver à créer de nouvelles formes de représentation, qui rejettent les codes occidentaux, orientalistes et paternalistes quitte à en devenir quelque peu opaques pour le néophyte — É. Glissant parle très bien de ce “droit à l’opacité”. Ces images se doivent d’être suffisamment puissantes pour s’imposer d’elles-mêmes comme évidentes. C’est en partie à cela que la mise en scène sert dans mon travail. Elle permet aussi de tisser une trame narrative au sein de chaque œuvre, et entre-elles au sein du Riad.
De plus, j’ai la conviction que toute représentation est nécessairement trompeuse car tronquée. En photo, cependant, l’on a souvent tendance à oublier cela à cause la pseudo-transparence du medium. Barthes définissait la photographie comme la preuve irréfutable qu’une réalité a existé à un certain moment, mais la photo objective n’existe pas. Si les formats de représentation dont je vous parlais tout à l’heure ont gagné tant d’importance c’est aussi parce qu’ils passent pour « impartiaux ». Je cherche à éviter cela. La puissance de Riad vient justement du fait que c’est une réalité très particulière, sublimée, un mélange de plusieurs époques, un condensé d’héritages, parfois surréaliste qui n’a pas l’ambition de supplanter la réalité.
Peux-tu nous décrire les deux photos que nous exposons actuellement au MACAAL dans l’exposition Africa is no island ?

Haya Jat (Starifixion)
J’ai grandi dans ce cinéma, en allant y voir des films très souvent, de ceux de Nabil Ayouch aux grandes prods hollywoodiennes à des classiques intemporels, variés, de de Funès à Chaplin. Je connais intimement tous ceux qui y travaillent depuis que je suis né, c’est un environnement si familier qu’il m’a semblé naturel de l’inclure dans les murs du Riad. Plus encore, il eu été presque contre-nature, artificiel, de ne pas inclure le Colisée dans Riad.
À travers mon enfance, après chaque séance à laquelle j’assistais, je me souviens que feu mon grand-pere me demandait toujours “la salle était-elle pleine?”. C’était souvent le début d’une conversation où il me racontait une histoire sur le cinema, la famille, son histoire et/ou celle de Marrakech et du Maroc. Dans les années 80, les gens y allaient en robe de soirée ou en costume, c’était quelque chose, comme l’opéra aujourd’hui j’imagine.
À travers cette photo et sa mise en scène (l’éclairage que j’utilise s’articule d’ailleurs autour des mêmes lumières halogènes utilisées justement au cinéma dans la première moitié du 20e, avec en plus les lampes au sodium du cinéma qui donnent cette teinte orangée et qui répondent à ma pratique argentique qui elle-meme date d’un autre temps) je suis certes nostalgique d’une époque que je n’ai pas connu, mais que, paradoxalement, je ressens tellement encore dans mes souvenirs du Maroc. Cela n’exclut pas de célébrer également un présent qui peut être tout aussi glorieux que l’idée qu’on se fait du passé. Ma tante est seule, cheffe d’un orchestre qui n’est plus mais qui perdure dans le cœur et la mémoire, et la salle est pleine.

Fatiha (Post-Anterior Medium)
Le salon où cette photo a été prise était la chambre de mon grand-père, celle où il me racontait l’histoire de la famille, de Marrakech etc. Il y a un hommage à plusieurs niveaux: tout d’abord à mon arrière-grand-père, dont deux portraits sont accrochés. C’est aussi une mise en abyme puisque ces portraits ont été pris à la fin du 19ème siècle, probablement avec un appareil similaire à la chambre 4×5 que j’utilise. Le portrait de gauche a été peint à la main, un clin-d’oeil à ma technique d’impression au pigment. Le miroir oxydé et le poste de télévision cathodique des années 70 permettent aussi de placer l’oeuvre dans une époque distante, un passé révolu. Mais dans le même temps, la tele fonctionne encore, puisque l’on peut voir le bruit de l’image, et le miroir comprend le reflet d’une des lampes halogenes–on peut aussi deviner le trépied de l’appareil photo et la chambre elle meme au milieu du miroir; il y a aussi un relfet dans le televiseur. Cela permet de ramener l’image dans le temps présent, celui oú la photo a ete capturée. L’alternance des bandes grises sur le televiseur rappelle aussi la mécanique/l’optique du processus de capture photographique, puisqu’elle est le resultat du mouvement rapide du tube cathodique dans le boitier (invisible a l’oeil nu, mais capturé par l’appareil photo).
À un autre niveau, il y a un hommage à mon ancêtre, de part le positionnement des portrait dans une mise en scene qui rappelle celle d’un autel. Cependant, le miroir, en position centrale, qui devrait renvoyer l’image de ma tante, la place aussi au centre de cette célébration. Les fleurs et les reservoirs à huile de fleur d’oranger sont partie integrale de cette métaphore. La posture de ma tante, éminemment religieuse dans son évocation de la priere en islam, et de part la forme de croix que son caftan dessine, fait appel à une spiritualité qui peut toucher un public universel. Néanmoins, elle a la tête haute, ce qui perturbe quelque peu une lecture purement de priere et/ou de suomission, et ses cheveux fauves interrompent franchement une telle interprétation. Elle est en fait en position de pouvoir. Le reservoir de travers à droite vient aussi casser cet équilibre, c’est sa marque dans son environnement. Un environnement qu’elle controle completement, qui est elle puisque son caftan s’integre au tapis (sous les tables). Plus que la « maitresse de maison », elle est la raison d’être de son environnement, du Riad.