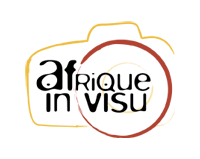Les absents sont là. Face à nous. Avec eux.
Ils posent. Elles posent.
Un jour, une femme est venue à la rencontre de « ces gens-là ». Son regard s’est arrêté et nous arrête à ce que disent ces vies. (…)
Ils sont là, face à elle, eux, les oubliés.
Eux, les victimes d’une double peine : le deuil et le silence.
Eux qui cohabitent depuis si longtemps avec le malheur et la misère affûtés, depuis le jour où leur vie a basculé, par le désespoir qui rancit jusqu’au goût des lendemains. (…)
Oui, ils posent. Eux sont debout et vivants. Malgré tout. Saisis en cet instant si bref, le temps d’un déclic, dans la dignité de leur souffrance. Une souffrance qui dépasse l’instant et nous questionne. Instamment.
Maïssa Bey. (Préface du livre « A fleur de Silence », éditions Barzakh)
L’Algérie a vécu des heures sombres durant les années quatre-vingt-dix. Certains l’appellent la décennie noire, d’autres la « décennie rouge » car beaucoup de sang a coulé. Un déchainement de terreur a secoué le pays par des assassinats, des enlèvements, des attentats et des meurtres collectifs. Ces exactions se comptent par millier.
La région de Blida, située au cœur de la Mitidja, à l’ouest d’Alger a vécu de plein fouet ces horreurs. Des hommes et des femmes rencontrés en juillet 2009, alors que le pays a retrouvé une certaine tranquillité, veulent se souvenir de leurs morts et de leurs disparus. La région de Boumerdès a également subi ces événements tragiques au plus fort de la décennie noire. La particularité est qu’aujourd’hui encore, la région vit de manière latente le terrorisme.
Ce travail propose un regard sur des algérien(ne)s qui ont vécu de manière intime ces événements dans ces deux régions. Les questions qui sous-tendent ce projet, sont comment vivre et se reconstruire après un tel traumatisme… C’est un travail de mémoire parcellaire qui n’a pas du tout la prétention de parler de cette période de manière globale.
Ce projet a été réalisé avec la collaboration de deux associations algériennes, Djazairouna (Blida) et Afak (Si Mustapha), ainsi que grâce au soutien du Comité International pour le Développement des Peuples (CISP).
Ce travail a fait l’objet d’un livre intitulé «A fleur de Silence».

Zohra
C’était en 1995. À l’époque, j’avais un frère qui faisait son service militaire. Des étrangers s’étaient présentés chez nous et avaient demandé où il se trouvait. Mon père leur avait répondu qu’il ne savait pas.
Un autre frère, Hocine, a fini par être enlevé dans la rue, alors qu’il se rendait à son travail. On l’a cherché quatre jours durant. Le quatrième jour, dans l’après-midi, mon père, Hamed, a été enlevé à son tour sur le chemin de la maison. Une semaine après, ce fut mon deuxième frère, Khalil. Ma mère s’est mise à les chercher partout, faisant des allers et retours entre le commissariat de police et l’hôpital. Avec mon grand frère, ils ont décidé, un mois plus tard, de déménager à Boufarik. Un jour qu’elle venait chercher des vêtements dans l’ancienne maison, elle a elle-même été enlevée. (…)

Mohamed
Les terroristes sont venus et ont tué tous les occupants de la maison : mon père, ma mère, sept de mes neveux, ma nièce et ma tante. Nous habitions un hameau dans la montagne. Nous sommes d’origine paysanne, toute la famille vivait réunie. Les seuls rescapés sont mon frère et moi, car nous n’étions pas à la maison, et mes sœurs mariées, elles aussi absentes. Mon frère a survécu mais sa femme et ses sept enfants ont été assassinés. Ils ont tout brûlé.
C’était en 1997.
J’étais agent de sécurité, donc je n’étais pas chez moi. C’est en rentrant du boulot que j’ai découvert le carnage. Et puis, il est vrai que je me cachais. J’étais leur cible car j’étais jeune. Ils venaient à la maison pour nous menacer. C’était des gens du coin, des voisins. On les connaissait ; parmi eux, il y avait même des amis. Ma mère me dissuadait de venir, elle disait qu’ils me tueraient et que je mourrais pour rien. (…)

Zohra
Le 22 août 1994, mon fils a été kidnappé au centre de formation professionnelle où il travaillait comme gardien de nuit. Il habitait le village agricole. Un an auparavant, il avait reçu des menaces : un tissu blanc et du savon avait été déposés dans son jardin, signe qu’il devait se préparer à mourir. Ils lui ont dit qu’il était l’ennemi de Dieu et qu’ils le tueraient. Son père habitait Oran. Nous lui avons conseillé de le rejoindre mais il a refusé. Il avait quitté son domicile et vivait caché. Il espérait pouvoir leur échapper et il n’imaginait pas qu’ils seraient si nombreux à venir le chercher.
Ils ont enlevé mon fils, l’ont emmené dans la montagne. Deux jours après, on a retrouvé son corps, pendu à une corde près du pont de la commune de Thénia. Il avait été égorgé. (…)

L.
Auparavant, j’habitais au centre de Si Mustapha avec mes parents. Après mon mariage, j’ai déménagé au village agricole qui se trouve près de la montagne. Ce quartier est habité, en grande majorité par des familles de terroristes. (…)
Ma fille a dix ans. Je ne la laisse plus jouer avec les enfants du quartier, qui lui racontent que les terroristes sont des moudjahidine et que les ennemis, ce sont les policiers. Un jour, alors qu’elle jouait dehors, elle a déboulé à la maison en courant, criant que les gendarmes avaient encerclé le quartier. Elle avait peur d’eux. Je l’ai rassurée en lui disant qu’ils étaient venus nous protéger, qu’ils étaient là pour traquer les terroristes.

Malika
C’était en 2004. Nous pensions alors que la paix était revenue. Mon mari est allé faire une promenade avec mon fils et le fils de sa deuxième femme. Ils voulaient passer la journée avec des amis, profiter de la campagne, c’était le ramadhan. Ils ont pris la voiture en direction de Médéa. Nous y avons une maison que nous avions habitée jusqu’en 1994. Nous l’avons quittée à cause des événements. Nous avions peur. La montagne est sans issue.
La route était barrée avec des arbres coupés : un faux barrage. Ils sont tous morts. La voiture qui a brûlé est toujours au même endroit. Depuis, nous vivons avec presque rien. (…)

La mère de Djamila
Après le ftour, tout était normal. Nous avons discuté pendant plusieurs heures, puis nous sommes allés nous coucher. Soudain, vers minuit, j’ai entendu des bruits sur le toit. C’était comme si une dizaine d’hommes marchait au-dessus de ma tête. Tout le toit tremblait. Je suis sortie dans la cour. Là, j’ai vu qu’ils avaient encerclé la maison. Ils étaient plus d’une trentaine, et parmi eux, un gars du village qui connaissait très bien Mohamed, un ami d’enfance. Puis, ils ont tout saccagé.
Un des terroristes a demandé à Mohamed de le suivre, pour discuter dehors. Je lui ai dit qu’il pouvait parler à mon fils à l’intérieur, il a refusé. Mohamed lui a expliqué qu’il était malade, qu’il ne pouvait pas sortir, il lui a montré ses médicaments. Mais le barbu était déterminé.
Ils l’ont emmené. Pendant trois jours, j’ai attendu. Hélas, le troisième jour, les terroristes sont venus remettre la tête de Mohamed à sa fiancée.

Cherifa
Je suis la présidente de l’association Djazaïrouna. Elle a été créée en 1996, suite à l’assassinat de plusieurs membres de ma famille : mon oncle paternel, le 11 mars 1996, ma sœur et mon frère, le 24 juin 1996, sept membres de ma famille le jour d’un mariage, à la mi-août.
À l’enterrement de mon frère et de ma sœur, plus d’un millier de personnes est venu. Ma mère, à plusieurs reprises, m’a dit la chance que nous avons eue d’avoir été autant soutenues. Avant cette période, les victimes du terrorisme se retrouvaient à quatre ou cinq pour les funérailles. Les gens avaient peur d’être portés sur la liste des condamnés à mort et d’être exécutés, donc ils ne se rendaient plus aux veillées, n’assistaient plus aux enterrements.
Nous avons donc créé cette association pour apporter du soutien aux gens, en hommage à celui que nous avions reçu et qui s’était structuré si spontanément. Nous voulions organiser le soutien. Ainsi, nous recevons les victimes, les parents des victimes, les enfants des victimes et nous leur apportons une aide morale, psychique, administrative.
Nous essayons de faire de notre mieux.
Quand on évoque les années 90, on parle de « décennie rouge ». Pourquoi ? Quand on entrait dans une maison où un massacre avait été perpétré, il y avait du sang partout, sur les murs, sur le sol, partout.