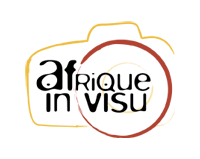Photographe de l’Agence France Presse à Abidjan, il connaît mieux que quiconque le terrain de la crise ivoirienne. Depuis le coup d’État de Guéï en 1999 jusqu’à l’investiture d’Alassane Ouattara: une trentaine de photographies retracent dix ans d’histoire en Côte d’Ivoire. C’est le voyage fulgurant dans lequel l’exposition d’Issouf Sanogo à Visa pour l’Image nous embarque.
Issouf Sanogo, vous êtes un peu un mystère. Tous ceux qui ont suivi l’actualité ivoirienne, notamment depuis les élections qui confrontaient Laurent Gbabo et Alassane Ouattara, connaissent bien les photographies que vous avez produites pour l’AFP et qui ont été publiées jour après jour dans de nombreux médias internationaux. Mais finalement on sait très peu de chose sur vous. Parlez-nous un peu de vous, de votre vie…
Je suis né à Agboville à environ 80 km au Sud d’Abidjan, le 18 février 1964. Je suis marié, j’ai cinq enfants, la plus âgée est née en 1986 et la dernière a 3 ans et demi, mais vraiment c’est la dernière !
J’ai commencé la photographie très jeune, en 1980, avec un indépendant qui avait un studio. En Côte d’Ivoire, l’Institut des Arts a un département photographique, mais à l’époque ils n’avaient ni les moyens ni l’équipement. Mes premiers pas dans la presse remontent à 1983-1984 avec Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental qui, dans ces années-là, était le seul journal du pays. Ils avaient des correspondants dans tous les départements. J’ai débuté avec le correspondant d’Agboville: on faisait des petits reportages.
L’exposition que vous présentez à Visa pour l’Image, au Couvent des Minimes, est une sélection des photographies que vous aviez réalisées pour l’AFP en Côte d’Ivoire entre 1999, du Coup d’État de Guéï, et mai 2011, jour de l’investiture d’Alassane Ouattara. En regardant cette chronologie ultra-condensée de plus de dix ans d’actualité ivoirienne on a l’impression que le désordre et la violence n’ont jamais vraiment cessé pendant toutes ces années…
Oui, malheureusement ça a été comme ça pendant dix ans. L’exposition présente des images d’actualité sélectionnées par l’équipe du Festival. Je n’ai pas travaillé dans la perspective d’une exposition. C’est Visa pour l’Image et le service communication de l’AFP qui ont décidé d’organiser une exposition sur mon travail sur ces dix ans de crise ivoirienne. Je n’ai pas participé au choix des photographies . Dans l’ensemble, elles retracent assez bien ces dix années de crise, mais certaines n’ont pas pu être incluses car elles étaient trop violentes pour une exposition que des familles vont voir. Je ne suis pas mécontent du choix qui a été fait et surtout je suis très heureux d’être là.
Est-ce un avantage d’être un Ivoirien sur le terrain, ou est-ce qu’au contraire cela vous a créé des difficultés ? Quelle a été votre liberté pour travailler sur le terrain ?
Par moments, cela a été un atout. La Côte d’Ivoire c’est un petit pays, nous nous connaissons tous. En plus cela fait longtemps que je suis dans la presse et je connais pas mal de monde. Ca a été un atout parce que même dans les moments un peu chauds je peux me fondre dans la foule, tant que je ne sors pas le boîtier on peut me confondre avec les autres. Et puis, j’ai de l’expérience aussi, je ne sors pas directement mon boîtier, il faut observer, évaluer le danger. Mais très souvent les gens ont besoin de nous, ils ont des meetings, organisent des manifestations, ils ont besoin de la presse. Même les fervents supporters de l’ancien président Laurent Gbagbo ont eu besoin de la presse pour leurs rassemblements. Ils envoyaient leur service d’ordre chercher les journalistes qu’ils encadraient et protégeaient ensuite dans les moments vraiment tendus. Tout le monde a besoin de la presse!
Et les manifestants de la rue ont aussi besoin de vous ?
Dans la rue ils n’ont pas vraiment besoin de nous. Mais quand on est sur place on essaie d’expliquer à ces gens que s’ils manifestent c’est pour une cause et que, s’il n’y a pas la presse pour relayer cette cause, ils ne seront pas entendus. Et ils finissent par comprendre que c’est dans leur intérêt d’accepter le journaliste et que le journaliste ne vient pas faire des images qui vont servir à la police pour arrêter des gens ou quoi que ce soit. (…) Si je fais une photographie qui peut nuire à quelqu’un, je ne la publie pas.

Certaines de vos photographies, notamment celles qui ont eu beaucoup de succès auprès des médias occidentaux, ont été prises à des moments où, dans les rues d’Abidjan, la tension était à son comble. Je pense notamment à des photographies prises au grand angle, très proche des manifestants.
J’essaye toujours de me rapprocher car la meilleure photographie c’est vraiment quand on est juste à côté ! Par exemple celle de Laurent Gbagbo, présente dans l’exposition, celle où il tire la langue: j’étais vraiment à un mètre !
Vous avez documenté, pendant plus d’une décennie, l’enfoncement de la Côte d’Ivoire dans la crise, le déclin de son économie, la souffrance des populations civiles. En tant qu’Ivoirien, qu’avez-vous ressenti ? Est-ce qu’il y a un événement, une situation, qui a été particulièrement marquante pour vous ?
Oui, dans les derniers jours, quand je voyais de chez moi, tous les matins, des hommes et femmes fuir la commune d’Abobo. Jour après jour, je voyais les mamans, les enfants avec leurs bagages sur la tête, à pied, sous la pluie. Plusieurs fois, je les ai pris dans ma voiture pour les déposer un peu plus loin. J’ai ressenti ça avec le cœur et les tripes… Ce sont les politiques qui nous ont amenés jusque-là, jusqu’à ces extrêmes-là; ce sont des choses que l’on aurait pu éviter. On espérait que cette élection présidentielle allait nous sortir définitivement de la crise. ça a été une grande déception. J’ai couvert d’autres crises, au Liberia, en Sierra Leone, au Congo, au Tchad, mais quand ça se passe à la maison, c’est plus difficile. Je ne m’arrêtais pas de travailler. C’était une page de l’histoire de mon pays qui s’écrivait, il fallait que je sois là. Les images restent. Sans images, on oublie. Dans vingt ans, cinquante ans, nos enfants, nos petits-enfants verrons qu’un jour, il y a eu cette situation dans le pays. Il faut toujours partir du passé pour construire le présent et le futur.
On sait, et vos photographies le montrent très bien, que les civils ont beaucoup souffert durant ces années de crises. Chaque famille ivoirienne a été touchée d’une manière ou d’une autre. Beaucoup de civils se sont même directement impliqués dans le conflit. Les Ivoiriens ont dû choisir leur camp. Comment vous êtes-vous positionné en tant que citoyen ivoirien et en tant que journaliste documentant cette situation ? Avez-vous dû choisir un camp ?
Cette série de « news » réalisée jour après jour pour l’AFP rend finalement assez bien compte de la durée et de la complexité de la situation en Côte d’Ivoire. Au quotidien, sur le terrain, aviez-vous conscience d’être en train de réaliser un tel document ?
Sur le terrain, je n’en avais pas conscience, c’était mon boulot de tous les jours pour l’Agence. Mais avec le recul, je réalise aussi que je participe à l’écriture de l’histoire. Je pensai faire une exposition, mais pas maintenant, plutôt quand les choses se seraient normalisées. Une exposition qui reviendrait sur les événements de 1990 jusqu’à 2011. J’ai pas mal de documents des années 1990. À l’époque, Laurent Gbagbo était l’opposant historique, c’était des grands rassemblements, j’ai tout en images. Si Dieu me garde, dans quelques années je ferai une exposition en Côte d’Ivoire, sur le processus démocratique.
Avez-vous eu envie de réaliser des reportages documentaires à plus long terme, ou est-ce vraiment l’actualité brûlante qui vous passionne ?
Mon travail à l’AFP me prend beaucoup de temps, encore plus maintenant que je coordonne le bureau. Ça me laisse peu de temps pour faire un travail à tête reposée. En Afrique, ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais je n’ai vraiment pas le temps. Pendant quelques années, j’ai suivi un copain cinéaste, Sidiki Bakaba, qui a été nommé depuis, directeur du Palais de la Culture à Abidjan. J’ai des images vraiment belles, en noir et blanc et il n’arrête pas de me dire qu’il faut préparer une exposition. Je voudrais bien, mais c’est le temps qui me manque.
Vous êtes, avec le Sud-Africain Joao Silva, un des deux seuls photographes africains à exposer à Perpignan. Qu’est-ce que ça vous inspire ? Que pensez-vous de la représentation de la photographie Africaine ici ?
Ça fait plaisir d’être là! C’est valorisant à titre personnel. L’AFP a de très bons photographes, et si l’AFP et Visa pour l’Image choisissent de présenter mon travail ça fait plaisir !
Il y a peu de photographes, qui ont la chance d’exposer dans ce festival, et encore moins les Africains. Peut-être que les Africains n’y pensent pas, et puis exposer à Visa pour l’Image ça ne se fait pas comme ça. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs photographes Africains, mais il faut bosser pour exposer à Visa pour l’Image.
Maintenant, il y a une nouvelle génération de photographes très entreprenants, ils sont bons, mais peut-être n’ont-ils pas les moyens. Le matériel coûte cher, et il n’y a pas de cadre. En Afrique, en général, les politiques s’intéressent peu à la photographie. Si au niveau du Ministère de la culture il y a une structure qui encadre, qui crée les conditions, ça donnera l’occasion aux photographes de présenter leur travail, mais si ce cadre-là n’existe pas… Le seul pays où il y a un événement photographique en Afrique c’est au Mali avec la Biennale de la photographie de Bamako. Tout ça c’est du domaine de la politique. La culture devrait faire partie des priorités des gouvernements africains.
La fin de votre exposition est en fait un commencement, celui de la présidence de Ouattara que l’on voit représenté lors de sa cérémonie d’investiture en mai 2011. On imagine que c’est aussi le début d’un nouveau travail journalistique pour vous. Votre vie étant intimement liée à la vie politique de la Côte d’Ivoire d comment voyez-vous le futur du pays ?
Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a eu beaucoup de déceptions par le passé. À chaque fois qu’il y a un début, ça suscite beaucoup d’espoir et ça se termine par le désespoir… Depuis le décès d’Houphouët-Boigny, tous les espoirs successifs ont été déçus. Donc je reste prudent. J’ai confiance dans le président Ouattara, vu son parcours et vu son expérience professionnelle et personnelle. Dans l’opposition, il a souffert aussi, il a échappé à la mort, et a été contraint à l’exil. Il a intérêt à ce qu’il y ait une ouverture démocratique, à ce que les partis et les gens s’expriment librement et à ce que la presse soit libre. C’est d’ailleurs les conditions qu’il avait posées au président Houphouët-Boigny avant de prendre la tête de son gouvernement en 1989. Je pense que ce sont des valeurs qui lui tiennent à cœur et, je pense et j’espère qu’il ne va pas décevoir. Depuis qu’il est au pouvoir, les changements sont visibles, Abidjan s’était complètement dégradée. Depuis quelque mois, il y a des travaux, des chantiers, les routes sont en train d’être réparées et nettoyées. Le travail accompli est déjà énorme, ça fait plaisir et redonne de l’espoir.