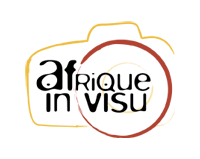Négril, à l’Ouest de la Jamaïque. Des chaises longues en plastique sont alignées sur une étendue ennuyeuse de sable blanc, devant un chapelet d’hôtels all inclusive et leurs restaurants en terrasse. Piscines débordant sur la mer et tables garnies sans vue sur la misère. Une foule blanche et joyeuse déambule dans un défilé de sandales en plastique, de maillots de bain et chemises légères. Une frise de catamarans et planches-à-voile se dessine à l’horizon caribéen. Un reggae lascif semble sortir tout droit de quelques cocotiers, et se frayer un chemin entre les verres de punch et les parasols. Du Reggae et de la culture Rasta on n’a ici retenue deux mots assaisonnés à toutes les sauces : One love !
Une femme jamaïcaine d’une trentaine d’année tresse une jeune fille blonde en lui apprenant quelques expressions locales qui agrémenteront sa panoplie de la parfaite touriste en recherche d’une d’authenticité de façade. Une retraitée à la peau laiteuse se fait masser par une jeune homme noir sec et musculeux, arborant quelques dreadlocks. La différence d’âge, de culture, les souvenirs des champs de canne et le mépris réciproque profondément ancré cèderont bientôt aux chant des sirènes vertes du dollar. Deux officiers de la police touristique, bâton à la main et casque colonial sur la tête, veillent à l’étanchéité de cette enclave. L’authenticité jamaïcaine distribuée au compte-gouttes aux foules malades du Nord-Atlantique.
Liguanea, petit émirat d’enseignes de restauration rapide, de cinéma, d’agences de voyage et de magasins de vêtements de marque au beau milieu du désert économique étouffant de la capitale Kingston. Des véhicules tout-terrains japonais étincelants avancent péniblement entre deux intersections de la large avenue. Les lotissements adjacents abritent derrière leurs murs élevés de belles villas ombragées et des appartements sentant le neuf. Les étudiants de l’Université toute proche déambulent dans des malls à plusieurs étages, téléphone portable dernier cri branché sur l’oreille.
La Jamaïque, pourrait-on dire, résumée en deux lieux insipides qui concentrent aussi bien les visiteurs que la classe moyenne locale.
Nous-nous sommes intéressées ici à l’envers de ce décor. A cette longue file d’attente endimanchée qui transpire sous un soleil de plomb, devant l’entrée de l’imposante ambassade des États-Unis. Aux raisons qui poussent les Jamaïcains à émigrer. Et surtout, à l’art de la survie dans une économie naufragée. Nous avons choisi de montrer cette Jamaïque à travers les portraits et parcours respectifs de quatre travailleurs jamaïcains.
Rosie
Rosie est cuisinière dans un petit local situé sur la route principale de 7 Miles, à Bull Bay, en banlieue de Kingston. Aidée de son mari, elle prépare 6 jours sur 7 des repas nourrissants et bon marché pour les employés de l’usine voisine de « black blocks », pour les conducteurs de camions qui fourmillent autour de la carrière de pierre située en contrebas, pour les pêcheurs et les employés des rares bureaux environnants, sans oubliés la meute de hustlers.
Le restaurant de Rosie est à l’image de son business, petit et précaire. Les toilettes du bar voisin fuient dans sa cuisine. Le ventilateur brasse péniblement un air lourd et chaud. Le bâtiment transpire la poussière. Ici, la majorité des clients ne gagne pas même le salaire minimum – 140 dollars US par mois -, bon nombre n’ont pas d’activité régulière. Tous ont pourtant faim. Le spectre de la « protection » qui parasite tous les commerces de la capitale plane, la concurrence est rude.
A l’image d’un pays qui se lève avant le soleil, Rosie est sur les genoux à deux heures de l’après midi. C’est une fleur qui éclot dès l’aube, dans la poussière de Bull Bay, pour servir un porridge aux enfants sur le chemin de l’école et du « dos de poulet » frit – les abats – aux travailleurs du quartier. Comme à l’épicerie voisine il existe des portions adaptées à tous les budget. Ceux qui ne peuvent s’offrir la plus petite repartent avec un peu de riz arrosé avec la sauce du poulet en échange de quelques pièces. Rosie prie pour tous ses clients en difficulté.
Le 7e jour est entièrement dédié à l’Église voisine. Contrairement à la restauration, la religion est un business fleurissant dans un pays où les adhérents sont priés de reverser 10% de leurs revenus à l’institution sous peine de châtiment divin. D’où une multiplication à l’infini de cultes, la concurrence entre les paroisses et surtout un nombre incalculable d’églises.
Perché au volant de son pick up dernier cri, le prêtre passe sans un regard au milieu de la foule de travailleurs endurant qui se dirige vers son petit commerce. A la recherche de spiritualité et d’un sens à la pénitence de leur vie quotidienne, ceux qu’on appelle ici les 9 to 5 (« 9 heures – 5 heures », ceux qui ont un emploi formel) peuvent se rassurer, la délivrance, parait-il, est toute proche.
Preuve en est l’abondance des « 9 nights », les 9 soirées de veillée durant lesquelles on rend hommage aux morts. Ceux qui ont été fauché par les balles font quotidiennement la une des journaux. Les milliers de victimes d’un système de santé réservé aux plus riches disparaissent sans laisser de trace.

Greatus
Greitus est un hustler typique. Le hustler est le travailleur pauvre des économies ravagées par la chimiothérapie libérale. Il erre dans un secteur informel qui n’a pas de règles, qui n’offre aucun droit, et que la police jamaïcaine patrouille en pirate.
Comme son frère – Genius -, Greatus a reçu pour tout héritage un prénom en guise d’encouragement pour affronter les turbulences de la vie jamaïcaine. Dans la vingtaine, il jongle parmi les opportunités qui s’offrent à lui. Parti de la campagne il s’est installé il y a quelques années dans un village de pêcheurs situé en banlieue de Kingston. Le quartier compte déjà une foule de jeunes hommes comme lui, sans formation, sans activité ni perspective d’avenir. Rares sont ceux qui sont employés sur les bateaux. Ceux qui peuvent s’en offrir un se comptent sur les doigts d’une seule main. Pour survivre, Greatus commença en revendant, bien plus loin, des poissons rejetés sur la plage après une matinée passé sous le soleil des étals du marché. Quelques billets, quelques histoires. Avec 300 dollars (2,5 euros) on peut acheter une chambre à air percée chez un réparateur de pneumatiques pour camion. Sur cette embarcation de fortune, avec du courage, on peut affronter la mer et pêcher. Greatus pêche durant la saison. Par tous les temps il affronte la mer sur un lambeau de caoutchouc. Particulièrement lorsque les vallées déversent des flots d’eau boueuse dans l’embouchure de Cane river et que la houle est importante. Snook, baracudas, kingfish et autres tarpons géants viennent alors patrouiller près des côtes. Kingfish, c’est aussi le nom de la police qui taxe leurs activités dès que l’occasion se présente.
Durant l’hiver, lorsque la mer est calme et le poisson rare, tous les commerces sont bons pour remplir la « dutchy » (marmite en fonte artisanale). La spécialité de Greatus est la capture des oiseaux rares comme les perroquets, qu’on trouve en grand nombre près de son village natal. Commerce illégal, quelques billets, quelques histoires, quelques séjours en prison…
Le hustler est un véritable artiste du monde du travail. Bon nombre de hustlers font d’ailleurs en permanence la queue devant les studios d’enregistrement de la capitale. Comme le chanteur, sa qualité première est sa créativité. Qu’un cyclone vienne à emporter un pont et le hustler s’improvise porteur à travers la rivière en crue. Un autre propose de l’eau et du savon pour se rincer sur la rive. Durant les jours les plus chauds il vend des boissons fraiches…
A l’heure où le commun des « 9 to 5 » tend à se retrancher derrière les barreaux d’habitations forteresses, les hustlers donnent vie à l’espace en aménageant les croisements, les ruelles, les impasses, etc. Avec quelques palettes, une glacière récupérée et de la tôle on construit un bar, des tabourets, une solide table à dominos, une autre pour les paris sur les jeux de cartes, etc. Le sound system n’est jamais très loin. Dans un vieux tonneau éventré on rôtit du poulet et du poisson. Un microcosme se développe autour de deux feuilles de tôles rouillées et quelques planches, redonnant vie à des quartiers résidentiels asphyxiés.
La masse des hustlers remet en cause l’idée même de propriété privée, concept dont ils sont exclus. Le ministère du logement estimait ainsi récemment le nombre de squatters à 1 million. Greatus est réfugié dans une villa réduite à l’état de ruine chancelante par le passage du cyclone Dean. Après le passage de l’orage et la fuite des propriétaires, la maison a été dépecée de ses équipements, ses câbles électriques, et jusqu’aux dalles de la salle de bain en quelques jours. Reste une carcasse fissurée dont les ouvertures ont été bouchées avec du contreplaqué. La propreté des chambres squattées contraste avec la désolation du squelette de la maison, qui semble avoir été abandonné par les fourmis sur la plage. De même le calme et la confiance d’un hustler comme Greatus contraste avec la précarité extrême de sa situation et l’anxiété des propriétaires voisins.

Kytes
Kytes est un jamaïcain d’une cinquantaine d’années. Père de famille soucieux, commerçant de bouts de chandelles, de ventres de poulet et d’huile à la cuillère, agriculteur à la merci d’aléas climatiques et politiques, aussi imprévisibles que récurrents. Il a grandit pendant la période trouble qui a marqué l’accession à l’indépendance du pays. Lorsqu’il entre dans la vie active, dans les années 1970, on entend dans les campagnes de Portland l’écho des affrontements qui ravagent la capitale.
A 14 ans Kytes apprend les mille métiers de la construction. Les cymbales de l’indépendance résonnent, un nouveau drapeau est hissé au poteau. La monnaie s’effondre, l’inflation galope. A 20 ans Kytes coupe la canne aux Etats-Unis. Les plantations du Sud des Etats-Unis s’accordent mal avec les aspirations à l’indépendance des descendants d’esclaves. Kytes part au Canada, ramasse des pommes, et économise le fruit de son labeur. A Portland, région de peu d’intérêt pour les grandes firmes étrangères en raison du relief et de l’inaccessibilité, une partie des terres a été redistribuée. Certains se lancent dans la culture rentable mais risquée de la ganja, d’autres poursuivent le mirage touristique. Pendant ce temps Kytes plante sur les rives du Rio Grande des hectares de bananes et de café.
L’arrivée du FMI dans l’île à partir du milieu des années 1970, impose un changement de cap drastique. De la promotion de l’autosuffisance alimentaire on tombe dans le piège de la levée des restrictions sur les importations bon marché. Selon un obscur modèle économique bâtit par et pour la Grande Bretagne du 19e siècle (les prétendus « avantages comparatifs »), les anciennes colonies gagneront à s’ouvrir au commerce international. La Jamaïque mise sur le tourisme et la bauxite et importe… tous le reste ! Problème numéro un, ces deux secteurs économiques sont tenus par des gérants nord-américains qui ne laissent derrière eux que les miettes de leur activité, des plateaux éventrés et des plages privatisées. Problème numéro deux, mises en concurrence avec les agricultures subventionnées et modernes des Etats-Unis, les productions locales s’effondrent. Le lait condensé en boîte envoie par exemple directement à l’abattoir le cheptel laitier local.
L’île connait les conséquences de l’urbanisation sans industrialisation : les campagnes se vident, la capitale gonfle, des deux cotés les rares emplois s’évaporent. Il faut en plus désormais rembourser les gigantesques prêts contreproductifs qui ont permis aux Etats-Unis de maintenir au pouvoir un régime favorable face à la « menace » socialiste de 1980 à 1989.
Malgré les bas salaires et les conditions de travail dans les champs, la banane jamaïcaine ne peut rivaliser avec les productions des Républiques Bananières tenues à proximité par la United Fruit. Le FMI propose alors une seconde cure classique qui finira de mettre à genoux le pays. Le dollar jamaïcain est dévalué. De quasiment 1 contre 1, on passe progressivement à 1 dollars US pour 80 dollars jamaïcain actuellement. Grâce à ce régime fiscal destiné à attirer les investisseurs étrangers (le coût des salaires diminue d’autant), les industries doivent fleurir. En réalité, comme ce fut le cas dans la région en premier lieu à Porto Rico, puis ensuite en Haïti et en République Dominicaine, ces incitations labourent un terreau de misère sur lesquelles ne poussent que des zones franches. Pour les conserver il faut ensuite maintenir au plus bas droits du travail et salaires.
A mesure que la monnaie nationale s’effondrait, comme en témoignent les touches de l’antique caisse enregistreuse de son épicerie, Kytes représentait la Jamaïque chrétienne qui s’en sort à la force du poignet, avec une foi inébranlable et une résignation face à l’incurie et l’avidité de ses décideurs politiques. Ses activités sont innombrables : producteur de café, de bananes, éleveur de chèvres, gérant d’une épicerie, distributeur de gaz domestique, maçon, etc. Toutes les facettes de son habitation ont été rallongées, arrangées, et sommairement équipées pour en faire des chambres à louer. Chacune est occupée par une famille. L’ensemble est noyé dans la végétation, seule luxuriance du lieu.

Oba Simba
Oba Simba est un chanteur talentueux comme la Jamaïque en compte des centaines depuis que Bob Marley a imposé le reggae sur les platines des discothèques du Monde entier. Le mirage économique entretenu par une poignée d’artistes tournant régulièrement aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, et paradant à Kingston dans leurs voitures de sport dernier cri, crée des vocations dans ce désert d’opportunités.
Âgé de 35 ans, Oba est originaire du bidonville de Allman Town, dans le centre ville de Kingston. Il est passé par l’école voisine de Trenchtown, quartier qui a enfanté, outre les Wailers, les plus grands stars du reggae des années 1970. Ces deux « ghettos » se caractérisent par une misère chaude et poussiéreuse, régulièrement ponctuée par des averses de balles déversées par les armes automatiques des gangs politiques et de la police.
Tout en franchissant les nombreuses étapes qui jalonnent le parcours de chanteur dans un pays où la concurrence est rude, Oba apprend tous les métiers. Il commence dans le bâtiment, coule du ciment et plante des armatures en ferraille. Il est employé dans un magasin de location de vidéos, puis il répare des machines dans des magasins de photographie. Par la suite il part sur la côte touristique et est embauché dans un hôtel pour filmer les vacances des visiteurs fortuné à Montego Bay. Un employé gagne ici un peu moins de 40 euros par semaine, le prix d’un repas en terrasse.
De retour à Kingston en 2005, sa carrière prend un nouveau tournant avec l’enregistrement de quelques titres qui accrochent les ondes. Mais pour gagner en Jamaïque, il faut accepter d’avoir perdu d’avance. L’enregistrement d’un seul morceau revient au total à une centaine d’euros (enregistrement en studio, mixage, etc.), soit plus de deux semaines de salaire pour qui a la chance d’avoir un emploi . Un peu plus qu’un mois de loyer. Il faut ensuite diffuser le morceau pour le faire connaître. Aux débuts des Wailers, on se rappelle ici que Peter Tosh avait enfermé dans son coffre de voiture le directeur de la programmation de la radio nationale jusqu’à ce la voix de Bob Marley ne surfe les ondes. Aujourd’hui, dans un univers fait de barbelés et d’agents de sécurité armés, on glisse sous la table 50 000 JA$, l’équivalent de 500 euros, pour avoir son morceau dans une émission en vogue pendant une quinzaine de jours. Pour d’éventuels bénéfices il faut encore attendre. Les jamaïcains n’achètent pas de disques, si ce n’est les copies pirates qui seules sont proposées à un prix abordable.
L’organisation de l’ « industrie de la musique » jamaïcaine reflète celle des autres secteurs économiques : une poignée de propriétaires de studios d’enregistrement et de managers d’artistes empochent la majorité des revenus produits par des jeunes artistes originaires de ghettos de la capitale et des campagnes pauvres. Oba est de ceux qui choisissent de percer seuls.
Ce qui frappe le plus lorsqu’on rencontre Oba, c’est la manière dont il gère ce parcours chaotique, sa détermination et son énergie intacte. Toujours «le pas ferme sur les graviers », comme le dit fièrement le proverbe rasta. Spliff et sourire ne quittent pas ses lèvres. Oba a pourtant déjà perdu la moitié de son pied gauche lors d’un accident, alors qu’il travaillait sur un bateau, pour une compagnie américaine. « Il m’en reste un, give thanks » !
Les Auteurs
– Romain Philippon travaille depuis 2006 comme photographe et réalisateur indépendant. Son travail oscille entre commandes institutionnelles et projets personnels d’auteur, basés la plupart du temps sur la condition humaine, à différentes échelles sociales.
Il a publié un livre sur Madagascar et ses habitants en 2005, et publie régulièrement des photographies dans différents magazines culturels ainsi que dans la revue Altermondes.
En parallèle de son travail sur l’île de la Réunion (où il vit), il développe actuellement avec Romain Cruse différents projets sur les sociétés dans les caraïbes.
Site web : www.pendantcetemps.fr
– Romain Cruse, est né à Nantes, en 1982. Il a enseigné à l’Université de Mona, en Jamaïque, où il a vécu pendant plusieurs années. Il poursuit des recherches dans de nombreux pays de la région Caribéenne et est aujourd’hui enseignant-chercheur à l’Université des Antilles et de la Guyane, en Martinique.Il a écrit dans plusieurs ouvrages et revues scientifiques sur la Caraïbe anglophone, Haïti, la Colombie, le trafic de drogues illicite. Ses articles sur la Jamaïque sont notamment parus dans le Monde Diplomatique. En 2011, il sortira le livre « La Jamaïque, les raisons d’un naufrage », avec Fred Célimène, aux Presses Universitaires des Antilles et de la Guyane.
Site web : romaincruse.blogspot.com